András Forgách, « Fils d’espionne » (Gallimard, 2021, traduit par Joëlle Dufeuilly). Recension de Clara Royer.
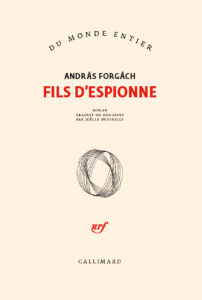 Moucharde ou « rose d’Hébron », « simple femme au foyer » ou « collaboratrice fiable, motivée et correcte », Bruria Avi-Shaul, nom de code « Mme Pápai », était, d’après un témoignage, un « oiseau de paradis multicolore qui, selon la légende, volait toute sa vie durant et ne redescendait sur la terre qu’au moment de mourir ». Elle était aussi la mère d’András Forgách qui, dans ce roman dont le lecteur français tient la version revue et corrigée de 2018 (dans l’élégante traduction de Joëlle Dufeuilly), s’efforce de préserver la pluralité de ces identités, essayant de surprendre leurs confondantes et brutales interactions – leurs cacophonies et leurs harmonies – dans l’histoire troublée de la guerre froide. Née en Palestine, mariée sans amour, citoyenne d’une Hongrie qu’elle n’aimait guère, où ni son mari ni son officier traitant ne partageait son goût de la musique classique, Bruria était privée de langue maternelle même si ses colères la poussaient à parler en hébreu ; « prise en tenaille entre deux patries, ou plutôt entre deux trahisons », elle donnait à ses rapports d’informatrice un style « foisonnant, riche en détails » : elle « tissait, tressait, brodait ».
Moucharde ou « rose d’Hébron », « simple femme au foyer » ou « collaboratrice fiable, motivée et correcte », Bruria Avi-Shaul, nom de code « Mme Pápai », était, d’après un témoignage, un « oiseau de paradis multicolore qui, selon la légende, volait toute sa vie durant et ne redescendait sur la terre qu’au moment de mourir ». Elle était aussi la mère d’András Forgách qui, dans ce roman dont le lecteur français tient la version revue et corrigée de 2018 (dans l’élégante traduction de Joëlle Dufeuilly), s’efforce de préserver la pluralité de ces identités, essayant de surprendre leurs confondantes et brutales interactions – leurs cacophonies et leurs harmonies – dans l’histoire troublée de la guerre froide. Née en Palestine, mariée sans amour, citoyenne d’une Hongrie qu’elle n’aimait guère, où ni son mari ni son officier traitant ne partageait son goût de la musique classique, Bruria était privée de langue maternelle même si ses colères la poussaient à parler en hébreu ; « prise en tenaille entre deux patries, ou plutôt entre deux trahisons », elle donnait à ses rapports d’informatrice un style « foisonnant, riche en détails » : elle « tissait, tressait, brodait ».
Pourtant, ce portrait maternel n’offre pas qu’une apologie du caractère protéiforme de l’identité personnelle, comme une attendrissante randonnée parmi les multiples soi que nous faisons grandir en nous. À l’origine du livre de Forgách, il y a un choc éthique, un bouleversement moral d’une grande violence : la découverte de l’activité de collaboratrice de sa mère avec la police secrète hongroise.
« Ou bien, un beau jour (pas si beau que ça tout compte fait), tu découvres que ta mère travaille pour la police secrète […]. Tout devient suspect, surtout la beauté, tout devient banal : la grandeur de l’âme, la générosité, l’altruisme. Un voile sombre recouvre tout, et on ne peut pas en parler.
On ne peut pas ne pas en parler. »
András Forgách, narrateur apparent d’un récit qui se présente en réalité comme une autofiction, est depuis longtemps une figure centrale de la scène culturelle hongroise. Né en 1952, il est dramaturge, scénariste, artiste, romancier et traducteur réputé – notamment du français. Formé au cœur de l’underground budapestois, il a préservé le caractère non conformiste de cette époque, tout comme son frère, le réalisateur Péter Forgács et sa sœur, Zsuzsa Bruria Forgács, artistes reconnus. Sans verser dans la nostalgie à peu de frais, le roman offre quelques belles pages sur cet univers de l’opposition culturelle des années 1970-1980, avec ses samizdats, ses pièces clandestines et ses figures devenues célèbres. On croisera ainsi le grand poète György Petri, le lunetteux Mihály Kornis, ou encore Dönci, le guitariste du groupe de rock Európa Kiadó. À l’heure où la contre-culture se fabriquait dans les appartements privés, celui du jeune András Forgách comptait – et personne ne semblait se douter qu’il était qu’empiété par la surveillance d’État. C’était (c’est toujours) un petit milieu, où « tout le monde connaissait tout le monde », pour le dire dans les mots d’István Rév (Retroactive Justice: Prehistory of Post-communism, Stanford University Press, 2005). Aussi les activités clandestines de Bruria n’affectaient-elles pas seulement potentiellement ses enfants mais aussi leurs amis. Sous la pudeur, on devine l’embarras qu’il y a eu pour l’écrivain de découvrir que cet espace privé avait été violé par sa propre mère. Car bien que personne n’eût douté de sa loyauté au régime, elle était si parfaitement intégrée à l’univers de ses enfants.
Mais ce monde n’est que l’un des nombreux décors du drame qui se joue dans le livre, un drame familial dont la protagoniste est Bruria Avi-Shaul. Fille d’un important intellectuel de gauche israélien, Bruria décide de s’installer après la guerre dans la Hongrie socialiste avec son mari Marcell Forgács, seul survivant d’une famille juive magyarophone de Roumanie décimée par la Shoah. Communistes fervents et antisionistes claironnants, ils prennent cette décision qui réimplante la famille Forgács dans l’histoire juive et hongroise du XXe siècle : le stalinisme de l’après-guerre, la révolution manquée de 1956, les relations internationales à l’époque du régime Kádár. La transformation de Marcell puis de Bruria en collaborateurs de la police secrète hongroise est aussi le résultat de cette traversée historique mouvementée qui façonne leur subjectivés d’une manière déterminante, jusqu’à la folie dans le cas de Marcell, qui finit dans un établissement psychiatrique au bout de la troisième dépression nerveuse.
Atermoyer le choc
Si le choc éprouvé par l’auteur en découvrant dans sa mère « une espionne, une moucharde » constitue le déclencheur du texte, il est toutefois différé pour le lecteur, qui ne le reçoit, dans toute son intensité, que dans la troisième (et dernière) section du livre. « András Forgách » s’adresse alors directement à ses lecteurs et les entraîne dans l’abîme du moment qui a tout changé, « comme si les lois de la perspective et de la gravité avaient été bouleversées » : la confrontation avec le dossier de collaboratrice de sa mère, et avec les activités d’informateur de son père.
L’approche diffère donc en substance d’autres récits consacrés au dossier, ces traces archivistiques laissées par les appareils de surveillance des pays socialistes. Péter Esterhazy, auteur d’un remarquable récit sur le dossier d’informateur de son père, commençait précisément par le choc, presque insurmontable, de la découverte du dossier : « Que dois-je faire ? Comme si c’était un rêve. Je vais tomber dans les pommes et ça résoudra tout. Ou je saute par la fenêtre fermée et je me sauve » (Revu et Corrigé, Gallimard, 2002, trad. Ágnes Járfás, p. 19). L’anthropologue américaine Katherine Verdery, qui travailla longtemps dans et sur la Roumanie socialiste sous les yeux attentifs de la police secrète roumaine, avait aussi mis en exergue les réactions variées et contradictoires qui l’avaient envahie alors qu’elle lisait pour la première fois son dossier de filature, réactions qui « ricochaient follement d’un sentiment à l’autre » (My Life as A Spy : Investigation in a Secret Police File, Duke University Press, 2018). András Forgách pour sa part sent le besoin de retarder la rencontre traumatique avec le dossier, de l’atermoyer presque, de ne se pencher sur elle qu’après que le filtre de la fiction a été mis en place.
Stylistiquement, ce filtre est très différent : la première section du livre (et aussi la plus longue), écrite à la troisième personne, est portée par la voix d’un narrateur à la fois tendre et distant, sinon ironique, qui raconte l’histoire de Bruria Avi-Shaul et de sa famille en la confrontant à des documents : lettres personnelles, rapports, listes, placés dans de généreuses notes de bas de page. Celles-ci renouent sans doute avec le genre du roman documentaire, qui entremêle récit de fiction et sources primaires, initié en 1974 par Mária Ember dans Virage en épingle à cheveu – un roman essentiel sur la Shoah hongroise. Mais on ne peut s’empêcher de songer à l’écriture de Péter Esterházy, figure tutélaire du livre avec lequel Forgách dialogue en sourdine, sans en reprendre les [l]armes et la colère.
Or, le narrateur de la première section se déplace au gré de son imagination dans le labyrinthe textuel laissé par la police secrète hongroise, rajoutant des détails ignorés de celle-ci, comme pour re-personnaliser l’inhumanité du style policier : drames amoureux, tensions familiales, pensées intérieures des personnages, scènes tragicomiques – comme ce passage dans lequel Marcell, alors expatrié à Londres, livre le récit de ses aventures au bordel à son fils de dix ans après avoir agressé un inoffensif émigré hongrois que sa paranoïa avait transformé en agent provocateur ! L’alternance des points de vue compliquent et mettent en perspective l’histoire donnée par le dossier. Elle s’ouvre vers une vision plus ironique de l’Histoire, visible en particulier dans les belles pages consacrées aux bâtiments budapestois : descriptions du siège de la police secrète, de l’appartement familial, etc. Avec la perspicacité d’un Sebald, le narrateur montre dans les transformations successives (et parfois absurdes) des pierres et des rues les méandres capricieuses de l’histoire de la ville et de ses habitants.
L’ironie reste audible dans la deuxième section du livre qui propose cinq poèmes en vers libres sur Bruria et Marcell, les parents « collabos ». Mais le lyrisme le dispute à l’ironie : un lyrisme retenu, qui souligne les tragédies éthiques de ces deux personnages emportés par une histoire marquée par la Shoah et la guerre froide. C’est seulement après ce double détour littéraire qu’András Forgách revient à l’avant-plan et parle ouvertement de sa rencontre avec le dossier.
Une autofiction historicisée
Fils d’espionne est loin d’être le premier récit dédié à ce genre de rencontre dans la littérature hongroise et centre-européenne. L’ouverture des archives des polices secrètes communistes a fait proliférer les œuvres qui se penchent sur l’expérience de la surveillance et/ou de la collaboration avec la police secrète : le livre d’Esterházy avait été précédé par celui de l’historien Timothy Gordon Ash sur son dossier de la Stasi (The File. A Personal History, Vintage, 1997), ou encore par l’essai de Péter Nádas, « Notre pauvre, pauvre Sascha Anderson » (1995) – ou pour sortir de Hongrie, par Moi, leur fils. Dossier de la Securitate de Dorin Tudoran (2010). Au point qu’il est raisonnable de parler d’un genre en soi, qui mélange écritures littéraire et policière ; un genre où la lecture du dossier figure comme expérience centrale. Pour prolonger les réflexions de la chercheuse Cristina Vatulescu (Police Aesthetics, Stanford University Press, 2010), on peut mentionner l’existence d’une « esthétique policière » qui influence la production littéraire en tant que telle, façonnant aussi son style.
À cette manne littéraire s’entremêlent les débats houleux sur la mémoire du communisme des trente dernières années, qui ont donné lieu à des polémiques fortement politisées où les actes des polices secrètes et de leurs collaborateurs ont toujours occupé une place centrale. Dans le contexte d’un discours anticommuniste, les accusations de collaboration ont souvent été utilisées dans les luttes sociales locales. Le champ culturel n’a guère été épargné par ces débats : qu’on songe aux affaires Milan Kundera, Christa Woolf, Jan Sokol ou, pour l’espace hongrois, aux scandales qui ont éclaté autour des réalisateurs István Szabó et Gábor Bódy. Le livre de Forgách a néanmoins paru dans un contexte moins électrique : le discours anticommuniste est désormais trop enraciné pour déclencher critique pertinente ou défense hardie. Les luttes autour de la mémoire du communisme semblent de moins en moins violentes, étouffées comme elles le sont par la victoire d’un anticommunisme institutionnalisé et, par conséquent, blasé.
Et pourtant, à sa parution en 2015, le livre de Forgách a déclenché de vives réactions dans l’espace culturel hongrois. Et même au-delà : l’œuvre a été traduite dans de nombreuses langues (15 ?). Comment s’explique cet intérêt constant pour l’agent, l’indic, le collabo, pour la rencontre avec le visage caché du socialisme d’État ?
L’échafaudage littéraire du livre offre peut-être une réponse à cette question. Il y a une parenté évidente, par exemple, entre le livre de Forgách et la tradition de l’autofiction française : le jeu entre réalité et fiction, le pari (presque toujours perdu d’avance) d’une transparence sans entrave et sans narcissisme. C’est une similarité remarquée par l’auteur lui-même dans un entretien en anglais occasionné par la traduction roumaine de son livre (dont on peut écouter l’enregistrement ici). Les multiples identités de Bruria appartiennent aussi à cette logique de l’autofiction familière au lecteur français.
Mais contrairement à la tradition française de l’autofiction, ce jeu d’identités entre dans le livre de Forgách dans une logique particulière : celle de l’historicisation, qui met en avant les identités multiples de l’individu (et pas seulement schizoïdes, comme le dirait Václav Havel) créées par l’État (socialiste) et surtout par la police secrète après la Seconde Guerre mondiale. Des chercheurs comme Katherine Verdery n’ont cessé de nous rappeler la capacité des appareils de surveillance – Securitate roumaine, Stasi est-allemande, ÁVH hongroise – à créer des nouvelles identités : « l’espionne », « l’opposant », « l’ennemi du régime », mais aussi l’informateur, le collaborateur, le membre du parti utile. Parfois, cette puissance va jusqu’à briser, fragmenter les identités : la chute dans la psychose de Marcell n’est-elle pas exactement cela, destin comme annoncé par le nom de famille aux consonances hongroises qu’il s’est choisi, forgács – soit « Copeau » ? C’est donc la capacité de la police secrète de coloniser la vie sociale et parfois même de changer sa signification, de reconfigurer les relations sociales ou le sens de soi des citoyens qui est révélée ici. C’est ainsi que Marcell Forgács devient Pápai (son nom de code) et sa femme, Bruria Avi-Shaul, Mme Pápai. Cette identité nouvelle, qui n’est vue et perçue que par les officiers traitants de Bruria et n’est contenue que dans son dossier de c.s. [collaborateur secret], forme néanmoins une grande partie de sa vie : c’est cette identité qui explique ses voyages en Israël, ses interactions avec des activistes sionistes, voire parfois, ses relations avec ses propres enfants.
Deux solitudes
Par conséquent, la peur d’András Forgách, la peur que maintenant « tout devient suspect, surtout la beauté » est aussi une peur de la contamination des moments les plus intimes de sa propre histoire par cette identité maternelle étrangère et obscure. Or, ce que les deux premières parties du livre soulignent avec sensibilité, c’est que cette identité n’était pas un masque occasionnel, un habit imposé de l’extérieur par le régime, mais qu’elle était intimement liée aux convictions, aux opinions et aux décisions cruciales des deux figures parentales.
D’une certaine manière, le pouvoir de la police secrète a consisté exactement dans sa capacité à s’insérer dans le sens de soi de ses victimes ou de ses collaborateurs. Certes, il ne faudrait pas céder à la tentation d’exagérer le succès de cette entreprise, et c’est l’un des mérites du livre que de montrer comment, même dans le cas de Bruria, communiste jusqu’au bout des ongles et recrutée comme espionne sur la base de son « patriotisme », le pouvoir de la police secrète se heurte toujours à des limites : les interactions de Bruria avec ses officiers sont plutôt caractérisées par des conflits et des malentendus. Bruria est incapable de passer ses convictions sous silence pour le bien de la cause et elle espionne mal. Que de soucis ses recrues ne posent-elles pas à cette police… Elle vit dans le monde et parfois le monde fait fi de leurs intentions et de leurs objectifs. Ainsi, Forgách livre un portrait saisissant de l’officier traitant József Dora, tiraillé entre sa fascination pour Bruria et les exigences de ses fonctions. Cette perspective contraste profondément avec les débats postsocialistes qui ont voulu tracer des limites (trop) bien définies entre « eux » et « nous », entre « le régime » et « le peuple », entre la police secrète et « la société ». Or ces frontières ont toujours été bien plus poreuses et mouvantes qu’on ne l’a admis.
Mais la tragédie de Bruria et de Marcell est bien plus profonde, dont les destins et les identités étaient déjà fragmentés, brisés par une histoire trop violente. C’est clairement le cas de Marcell, seul survivant de sa famille après la Shoah, dont la foi acharnée dans le communisme (jusqu’à sa propre collaboration) est une tentative de stabiliser une identité fragile, colérique, toujours sur le point d’éclater – et qui donne lieu à une scène d’errance urbaine à Londres en compagnie de son jeune fils, marquée par la volatilité de sa psyché. Mais c’est aussi la situation de Bruria, toujours en mal de patrie : étrangère dans un Israël que, antisioniste intransigeante, elle n’a jamais perçu comme sien, mal à l’aise dans une Hongrie socialiste qui semble à peine à la hauteur de ses efforts – et de ceux de son mari. Ces personnages trouvent rarement une place dans la fiction contemporaine ; exactement parce qu’ils s’intègrent mal et débordent toujours les fables nationales/nationalistes de tous les pays qu’ils traversent sans jamais y appartenir complètement : la Roumanie, la Hongrie, Israël. Une des forces de l’autofiction de Forgách est de décrire soigneusement – avec une attention qui ne peut être que l’œuvre de l’amour et de l’intelligence littéraire – l’errance et la solitude de ses personnages, ses parents.
Clara Royer
Illustration : Extrait de la jaquette de l’édition hongroise





