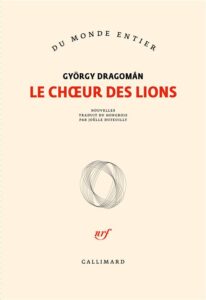 À l’instant où l’on ouvre Le Chœur des Lions, les premières notes retentissent, lancent le ton et placent la barre haute : ce sera virtuose. Dès les premiers mots, le lecteur est tiré hors de sa zone de confort. Sa mission est simple : suivre le rythme cadencé que nous impose – nous offre – György Dragomán dans ce bijou de littérature. De narrateur en narratrice, on voyage dans une partition parfaitement maîtrisée. Jamais de fausse note et les sons discordants sont instantanément rattrapés dans un accord parfait.
À l’instant où l’on ouvre Le Chœur des Lions, les premières notes retentissent, lancent le ton et placent la barre haute : ce sera virtuose. Dès les premiers mots, le lecteur est tiré hors de sa zone de confort. Sa mission est simple : suivre le rythme cadencé que nous impose – nous offre – György Dragomán dans ce bijou de littérature. De narrateur en narratrice, on voyage dans une partition parfaitement maîtrisée. Jamais de fausse note et les sons discordants sont instantanément rattrapés dans un accord parfait.
Traduction et mise en recueil
La traductrice, Joëlle Duffeuilly, relève sans faille le défi que constitue la langue de Dragomán. La prose semble étonnamment simple, mais attention, tout le piège est là ! Dans cette langue extrêmement millimétrée et maitrisée, chaque mot, chaque virgule occupent une place décisive et contribuent à former un chœur prosaïque. Malgré les différences intévitables entre la consonnance et la rythmique du hongrois et du français, les textes traduits restent tout aussi vivants, candides et joueurs que les textes originaux.
Le Chœur des Lions est un recueil hybride, qui combine des nouvelles soigneusement choisies par la traductrice. Certaines sont issues du recueil hongrois éponyme (Oroszlánkórus), et de Rendszerujra (« Système à nouveau », traduction littérale que je propose de remplacer par « Reset »). Le premier recueil a pour thème central la musique, le second l’enfance dans un pays autoritaire et totalitariste. Joëlle Dufeuilly a sélectionné avec grande finesse des extraits qui forment, tous ensemble, un très beau chœur dont les narrateurs et narratrices nous montrent un monde à travers leurs yeux d’enfants. Le grand art de Dragomán est de réussir parfaitement à se dévêtir d’une perspective adulte : son écriture trouve toujours la subtile tournure, le débit de parole, les métaphores et les images qui nous font croire à l’écriture d’un enfant.
Des voyages inattendus
Le lecteur glisse d’histoire en histoire au son d’une mélodie remplie de joie enfantine et de mélancolie. Le livre commence et se termine par un concours fatal contre le violoniste noir : un flot de parole nous raconte la préparation sans relâche d’un jeune garçon sous pression paternelle, qui doit égaler et dépasser le maître de l’archet. « Quand je joue des airs rapides, le fauteuil de mon père accélère son balancement, il me crie de tenir le rythme, je dois penser au violoniste noir, je crois qu’il s’entraîne normalement mais je dois savoir que le violoniste noir s’exerce chaque nuit, au carrefour, avec la lune dans son dos, de façon à voir l’ombre de son archet se refléter dans la poussière de la route, et quand il joue suffisamment vite, son ombre n’arrive plus à le suivre, elle se détache de l’archet et reste dans la poussière, telle une flaque d’eau noire étirée en longueur, alors moi, je dois m’imaginer en train de jouer aussi vite que lui. » Les phrases à couper le souffle – littéralement, il n’y a presque pas de point – récréent la mélodie d’un air virtuose de violon. Le lecteur n’a même pas le temps de reprendre sa respiration. Quelques pages plus loin, impulsivement, nous montons dans un taxi et nous prenons l’avion avec un jeune homme en deuil pour rejoindre la Puerta del Sol et renouer avec un passé familial qui ne passe pas.
Musique !
Différentes carrières d’artiste défilent, du succès à l’échec. Au son de Cry me a river, une chanteuse de jazz nous laisse entrevoir des fragments de sa vie : sa première fois sur scène, ses relations, ses enfants, sa carrière. Se dresse alors devant nous un tableau sincère et mélancolique d’une femme, du temps qui passe.
Les cloches de Hells Bells retentissent : deux enfants, dans un système où « le rock est interdit », écoutent la célèbre musique d’ACDC qui filtre de derrière la porte de l’électricien barbu. Il est « le seul à posséder un magnétophone dans tout le bloc d’immeubles, les autres locataires ont des électrophones, mais on ne peut pas écouter du rock sur un électrophone, puisqu’il n’y a pas de disques de rock. » Les bêtises sont au rendez-vous. Vols, membres cassés, boules de neige dans la boîte aux lettres, chien adopté en cachette, il y aura toujours une petite anecdote, une manière de percevoir la vie des grandes personnes qui rappellera au lecteur sa propre enfance. Quelques pages plus loin, c’est le concert du Nouvel an qui retentit : devant une minuscule télévision cassée, une dame et une petite fille, toutes deux sur leur trente-et-un, essayent de s’abandonner à la fameuse valse retransmise avec difficulté depuis Vienne.
Un parfum de Reset (Rendszerújra)
À l’école, faut-il voter pour la colombe ou le fusil ? Choisir la guerre ou la paix ? Faut-il traverser la frontière ou rester chez soi ? Comment écouter les musiques interdites ? Dragomán nous offre une série de réponses touchantes et enfantines à travers ses nouvelles. Retour ou départ d’un pays totalitaire, le souvenir reste toujours teinté de douleur. Revenir sur ses pas ou traverser la frontière, les objets ont un aspect, une odeur différente, lourds du poids du passé. Pourtant, le souvenir est si vif que tout semble encore identique. Dans « L’argent familial », un petit garçon retourne dans son village natal : toutes les sensations reviennent instantanément, jusqu’au goût des dernières crêpes mangées. Dans « La frontière », Dragomán nous adresse la parole à la deuxième personne : « Tu te tiens devant la frontière, tu t’apprêtes à la franchir. Il y a deux ou trois choses qu’il n’est pas inutile de savoir avant de sauter le pas ». Le lecteur se sent au bord de cette frontière, il est submergé par les sensations de déjà-vu, de non-retour qu’il ne connaît pourtant peut-être pas. « Tu es pris de vertige, mais le monde ne tourne pas autour de toi, il semble plutôt s’éloigner, s’extraire de la réalité, tu as l’impression d’être ici, et de ne pas être ici, comme si la réalité s’était transformée autour de toi, n’était plus elle-même ». C’est cet indicible, cette chose qui nous échappe, mais que nous comprenons tout de même très bien, que l’auteur parvient à nous transmettre avec finesse et originalité.
Réalisme fantastique ?
Avec humour et bon goût, le réel côtoie le fantastique. À chaque page, on s’attend à ce que la réalité, souvent décrite avec une vision très originale mais d’autant plus véridique, soit soudain bouleversée par un léger événement surnaturel et hors du commun : un sort jeté par une femme sur son époux batteur, qui ne peut physiquement plus toucher son instrument dans « Le balai », le fauteuil à oreille d’un grand-père paralysé qui s’élance comme un cheval en pleine course hippique ou encore une salle de bain qui se remplit d’eau et nous fait découvrir « Presque tout ce qui est bon à savoir sur les poissons ». Tout le charme de l’écriture réside dans le subtil glissement du quotidien à l’incroyable. De l’incroyable au plausible. Du plausible au vrai. Car tout reste d’une sincérité pure, d’une candide singularité.
Avril 2024
Fanni Endrodi-Engel





