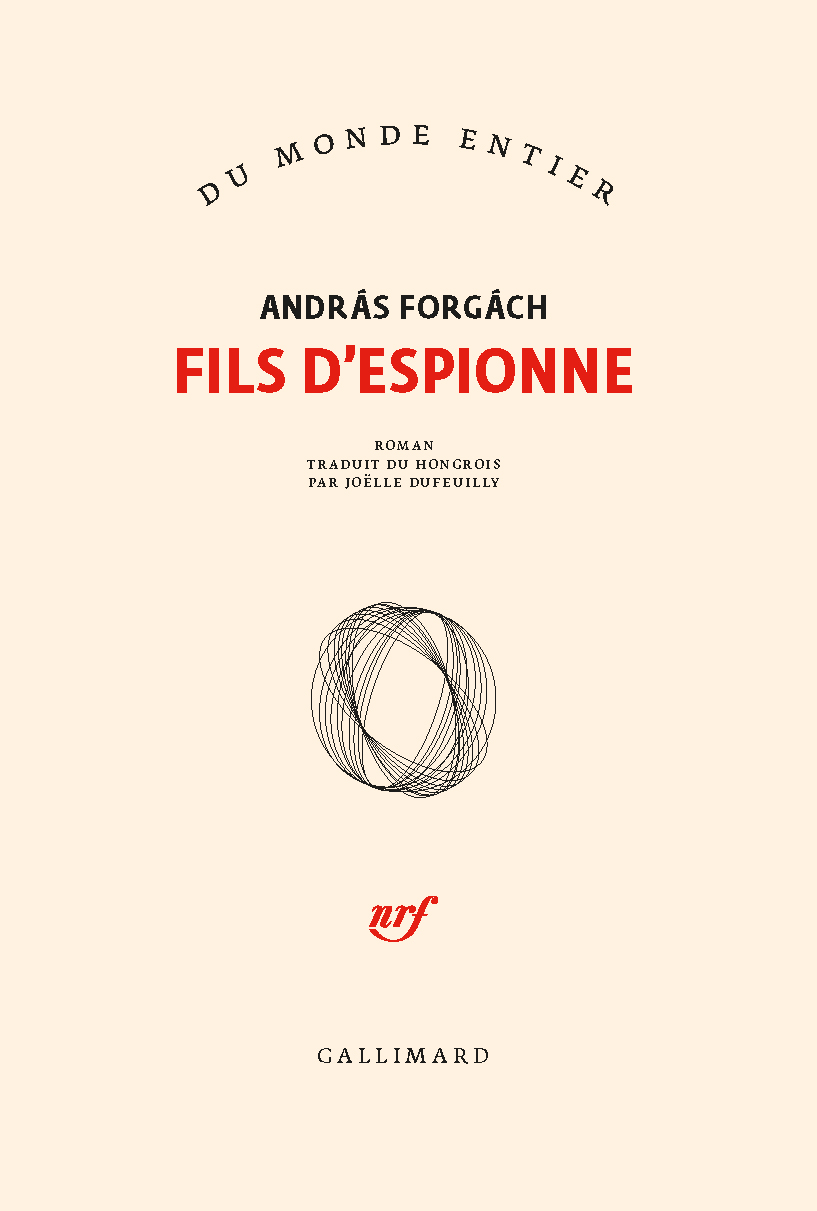Interview avec Gábor Vida et extrait de son roman « Là où est son âme », dans la traduction de Jean-Louis Pasteur, premier prix du Concours de traduction de l’Institut culturel hongrois.
Il est intéressant de noter que presque tous les critiques hongrois se sentent obligés de définir l’œuvre et qu’ils en donnent des définitions plutôt différentes : roman de la Première Guerre mondiale, roman de Trianon, roman de la Transylvanie, roman sur la quête de soi, roman de la statue de Matthias à Kolozsvár (Cluj en roumain), roman picaresque historique… Selon vous, quelle est la définition la plus appropriée ?
Le roman. Aujourd’hui, nous ne pouvons plus vivre avec ces définitions étroites du roman, tout comme nous ne pouvons déjà pas établir précisément ce qui fait qu’un roman est un roman. La Première Guerre mondiale, la quête de soi, Trianon, le picaresque, tous ces éléments sont bien présents, mais on trouve toujours des milliers de choses dans la plupart des romans. Je voulais évoquer Trianon, cela occupait mon esprit, je voulais mettre de l’ordre dans mes idées. J’entends par là, non pas le traité de paix proprement dit, mais tout ce qui l’entoure, ce qui a précédé et ce qui a suivi.
 « Les sentiments et les désirs semblent tout droit sortis d’un film sentimental de l’entre-deux-guerres. Un grand amour, une grande passion, une grande perte » [1], écrit l’un des critiques. La prévisibilité des éléments romantiques semble être contrebalancée par l’imprévisibilité du récit : « […] le style particulier de la prose de Vida, qui reste obstinément fidèle à la narration “régulière”, est tout aussi fragmenté et autoréflexif que celui de nos meilleurs auteurs postmodernes. » [2] Pour raconter une histoire qui s’étend sur des décennies, le jeu avec les temps du roman, l’utilisation fréquente du flashback ont dû être, je suppose, des outils importants…
« Les sentiments et les désirs semblent tout droit sortis d’un film sentimental de l’entre-deux-guerres. Un grand amour, une grande passion, une grande perte » [1], écrit l’un des critiques. La prévisibilité des éléments romantiques semble être contrebalancée par l’imprévisibilité du récit : « […] le style particulier de la prose de Vida, qui reste obstinément fidèle à la narration “régulière”, est tout aussi fragmenté et autoréflexif que celui de nos meilleurs auteurs postmodernes. » [2] Pour raconter une histoire qui s’étend sur des décennies, le jeu avec les temps du roman, l’utilisation fréquente du flashback ont dû être, je suppose, des outils importants…
Lorsque j’ai déclaré dans une interview que je voulais écrire de la prose traditionnelle, mes mots ne visaient pas les textes publiés, mais plutôt les théories à la mode qui avaient alors cours dans le discours critique hongrois ; elles affirmaient qu’il n’y avait pas d’« histoire » et que même raconter une histoire relevait de l’impossible. Pourtant, les écrivains capables de discourir avec grâce sans devoir passer par le récit sont peu nombreux. On ne peut certes nier l’existence de Jacques le fataliste, de Tristram Shandy ou d’Oblomov, mais rares sont ceux qui ont lu Ulysse jusqu’au bout, même parmi ceux qui prêchent l’impossibilité de raconter des histoires. On raconte quelque chose et on constate avec stupéfaction que l’on met en œuvre des procédés narratifs…
« Et bien qu’il ne m’appartienne pas de répondre à la question de savoir pourquoi cela a pu se produire, et plus précisément pourquoi nous avons laissé la Transylvanie nous échapper, je dirai en synthèse pour éviter les malentendus, que nous n’en avions pas besoin et qu’en plus nous ne la récupérerons jamais, car de toute manière nous ne saurions pas quoi en faire. Nous les Hongrois, donc à la première personne du pluriel ». Dès les premières phrases du livre, on comprend immédiatement le roman n’entend pas s’inscrire dans la lignée des « histoires transylvaniennes construites autour de l’injustice historique et du sacrifice »[3], sans pour autant « discréditer d’aucune façon la question du sentiment d’appartenance ». En écrivant ce livre, aviez-vous pour objectif conscient de régler vos comptes avec « le poncif littéraire rebattu de la Transylvanie »[4] ?
Je voulais comprendre ce qui était arrivé à la Hongrie au début du 20e siècle. Ce n’est pas facile, car il n’existe pratiquement aucune période au cours des dernières décennies que nous aurions pu accepter l’histoire de Trianon dans sa totalité. L’une des questions dérangeantes est de savoir ce que NOUS, nous avons fait pour empêcher ce qui s’est produit, nous les Hongrois. Ce que les Roumains, l’Entente, les Américains ont fait et n’ont pas fait, ça nous en avons une connaissance précise, mais notre participation à ces événements, à nous, les Hongrois, est une question douloureuse. C’est pourtant bien là que nous mène le voyage introspectif.
 « Seul celui qui ne sent pas la direction à suivre a besoin d’une carte », peut-on lire à plusieurs reprises dans le roman dont les héros – Sándor Werner et son fils, Lukács Werner – ne sont pas outre mesure effrayés ni par les grandes distances ni par la crainte de perdre leur chemin. Le premier cède avec amertume son grand amour, l’actrice de Pest, à un riche baron autrichien, et, renonçant à sa carrière militaire, s’installe dans le coin le plus reculé de Transylvanie avec l’enfant né de leur union. Une fois Lukács devenu adulte, il décide de partir avec lui en Amérique, où, inspiré par une idée pêchée dans un article de journal, il rêve de s’enrichir en exploitant des séquoias. Finalement, Lukács ne monte pas avec son père à bord du navire en partance pour le Nouveau Monde, mais guidé par une impulsion soudaine, il part de Fiume pour faire un safari en Afrique avec l’amant de sa mère, l’homme qui a généreusement financé ses études… Il traverse la Première Guerre mondiale quelque part entre l’Ouganda et le Kenya d’aujourd’hui. De là, en 1919, il retourne à Budapest occupée par l’armée roumaine, un monde où une carte (sans laquelle il serait impossible de connaître le nouveau tracé des frontières) et un document de voyage valide seront bientôt indispensables. Je me trompe beaucoup si je perçois ce livre comme une élégie pour ce monde soudainement rétréci, minuscule et fragmenté (pour augmenter encore le nombre de définitions associées à l’œuvre) ?
« Seul celui qui ne sent pas la direction à suivre a besoin d’une carte », peut-on lire à plusieurs reprises dans le roman dont les héros – Sándor Werner et son fils, Lukács Werner – ne sont pas outre mesure effrayés ni par les grandes distances ni par la crainte de perdre leur chemin. Le premier cède avec amertume son grand amour, l’actrice de Pest, à un riche baron autrichien, et, renonçant à sa carrière militaire, s’installe dans le coin le plus reculé de Transylvanie avec l’enfant né de leur union. Une fois Lukács devenu adulte, il décide de partir avec lui en Amérique, où, inspiré par une idée pêchée dans un article de journal, il rêve de s’enrichir en exploitant des séquoias. Finalement, Lukács ne monte pas avec son père à bord du navire en partance pour le Nouveau Monde, mais guidé par une impulsion soudaine, il part de Fiume pour faire un safari en Afrique avec l’amant de sa mère, l’homme qui a généreusement financé ses études… Il traverse la Première Guerre mondiale quelque part entre l’Ouganda et le Kenya d’aujourd’hui. De là, en 1919, il retourne à Budapest occupée par l’armée roumaine, un monde où une carte (sans laquelle il serait impossible de connaître le nouveau tracé des frontières) et un document de voyage valide seront bientôt indispensables. Je me trompe beaucoup si je perçois ce livre comme une élégie pour ce monde soudainement rétréci, minuscule et fragmenté (pour augmenter encore le nombre de définitions associées à l’œuvre) ?
J’étais cartographe dans l’armée roumaine (1986-88), les photos du général français Berthelot, dont les historiens hongrois disent pis que pendre, étaient accrochées au mur dans les bureaux de notre unité ; au demeurant, il était également détesté de ses subordonnés roumains, même s’il leur a rendu de grands services en réorganisant l’armée roumaine qui a marché sur la Transylvanie à l’automne 1918. C’est à cette occasion que j’ai pour la première fois feuilleté les cartes militaires austro-hongroises, j’ai été impressionné. J’ai rencontré des gens très bien dans l’armée roumaine, je pense que cela transparait aussi.
Il fallait que le héros s’enfuie quelque part, je ne voulais pas qu’il périsse au front, je ne voulais même pas qu’il combatte sur le champ de bataille, Remarque, L. F. Céline ou Hemingway avaient déjà tout écrit. Du reste, un de mes grands-pères a visité l’Amérique à deux reprises avant la Première Guerre mondiale, j’ai même trouvé son nom dans la base de données d’Ellis Island.
Je ne savais presque rien de ce qui se passait à Budapest ou à Kolozsvár en 1919 et 1920 ni de l’armée roumaine qui occupait la Hongrie, sur le plan militaire, c’était un scandale. J’ai même appris au collège que l’armée du Royaume de Roumanie avait écrasé la République des conseils hongroise. Encore aujourd’hui, beaucoup pensent que, quelles que soient les décisions que les autorités militaires hongroises auraient pu prendre à l’époque, rien n’aurait pu être évité. Je le conteste. Qu’il n’y ait pas eu de commandement militaire hongrois, ça, c’est douloureux. Je ne suis pas un historien militaire ni un politicien, j’ai donc le droit de le penser.
Les documents de voyage, c’est un tout autre sujet, car avant 1914, cela n’existait pas vraiment, ensuite et pendant un certain temps les gens ont voyagé avec toutes sortes de papiers dont la reconnaissance dépendait du bon vouloir des gardes-frontières. Et soudain, le monde est devenu tout petit, ce qui explique par exemple que le ministre hongrois des Affaires étrangères de l’époque (Miklós Bánffy) n’ait pas pu se rendre à Paris.
 Comme je l’ai déjà souligné, Kolozsvár joue un rôle extrêmement important dans le roman qui « dresse de la ville un tableau hyperréaliste, attentif à tous les détails, peint dans toute sa patine »[5], une ville où notre protagoniste finit par rentrer chez lui malgré toutes les difficultés. Pour reprendre le titre du livre : c’est la ville « où vit son âme », celle de Lukács Werner (cela ne fait pas partie des tentatives de définition, mais le livre est aussi un roman du retour). Pourquoi la ville de Kolozsvár et la statue de Matthias qui trône sur la place principale sont-elles devenues le point de référence, l’origine permettant de déterminer la position de tous les points dans le système de coordonnées du roman ?
Comme je l’ai déjà souligné, Kolozsvár joue un rôle extrêmement important dans le roman qui « dresse de la ville un tableau hyperréaliste, attentif à tous les détails, peint dans toute sa patine »[5], une ville où notre protagoniste finit par rentrer chez lui malgré toutes les difficultés. Pour reprendre le titre du livre : c’est la ville « où vit son âme », celle de Lukács Werner (cela ne fait pas partie des tentatives de définition, mais le livre est aussi un roman du retour). Pourquoi la ville de Kolozsvár et la statue de Matthias qui trône sur la place principale sont-elles devenues le point de référence, l’origine permettant de déterminer la position de tous les points dans le système de coordonnées du roman ?
J’ai étudié à l’université de Kolozsvár, et au début des années 1990, c’était toute l’hystérie nationaliste qui s’y déployait à petite échelle, à plusieurs reprises, ils ont voulu déplacer la statue, la statue du plus grand des souverains hongrois, et ils n’avaient pas choisi au hasard, c’était un geste symbolique de marquage territorial, manifestation coutumière du nationalisme roumain, à chacune de ses poussées.
Kolozsvár est une ville emblématique, assez grande à cette époque pour que l’on puisse y vivre incognito. C’est important dans un roman. Je me suis attaché à reconstituer méticuleusement l’environnement, le paysage urbain, j’y ai beaucoup travaillé. Lorsque la ville est suffisamment grande, on peut ajouter une maison, un visage, une place, personne ne le remarque. C’est beaucoup plus difficile dans une petite ville. Je redoute parfois les ajouts historiques qu’internet est susceptible d’engendrer.
Et puis, quand on a passé sa jeunesse à Kolozsvár, on est nostalgique, je pense que Paris fait le même effet…
De votre propre aveu[6], vous écrivez de la « prose traditionnelle ». De quelle tradition vous sentez-vous proche ? Au-delà des lieux et de l’expérience historique que vous partagez, ressentez-vous une parenté littéraire avec un autre auteur hongrois contemporain de Transylvanie ? Parmi ceux-ci, les noms les plus connus des lecteurs français sont peut-être ceux d’Ádám Bodor et de György Dragomán.
Je connais personnellement beaucoup d’éléments issus de l’univers d’Ádám Bodor, c’est l’un des auteurs les plus influents aujourd’hui. Quand les théoriciens dissertaient sur l’impossibilité de raconter une histoire en l’absence d’histoire, c’est en fait qu’il ne leur était encore rien arrivé, puis La Vallée de la Sinistra a paru, fermant la page du 20e siècle, on n’en revient toujours pas. Il y a deux ans, qui aurait pu croire qu’on allait relire La Peste de Camus ? Et ils disent qu’il n’y aurait pas matière à raconter d’histoire…
[1] Dénes Tamás, Elveszítve megtalálni [Se trouver en se perdant], Helikon, 2016. n°4
[2] Péter Pogrányi, A neheze, Műút [Le plus dur], 2014/06/15
[3] Dénes Tamás, Elveszítve megtalálni [Trouver après avoir perdu], Helikon, 2016. n°4.
[4] Gitta Benkő, Vida Gábor: Ahol az ő lelke, Vigília, 2014. n°9.
5] Norbert Vass, Messze jutni könnyű [Il est facile d’aller loin], litera.hu 21-12-2013
[6] Lelkesült prózaállapot és egy korty Erdély [Une prose enflammée et un zeste de Transylvannie] – Entretien d’Edit Gergely avec l’écrivain Gábor Vida. Új Könyvpiac, 08-04-2005
Interview : Gábor Orbán
Traduction : Anne Veevaert
Photos :
Émigrés sur le point de prendre la mer, Fiume, 1903 (Musée national hongrois)
Le général Holban à la tête des troupes roumaines, Budapest, août 1919 (Musée d’histoire militaire de Budapest)
La statue du roi Mathias à Kolozsvár (Fortepan – Németh Tamás)
Extrait du roman de Gábor Vida intitulé « Là où est son âme«
Traduction de Jean-Louis Pasteur
Premier prix
Concours de traduction de l’Institut culturel hongrois de Paris (2021)
Relecture : Catherine Fay

A Trieste, il comprit, sitôt débarqué, qu’il n’était pas revenu dans le monde dont il était parti : certes, comme ville, elle est plus belle et plus imposante que Fiume mais le sergent italien ne voit pas en lui le voyageur et, à vrai dire, ne s’intéresse guère à son passeport britannique couvert de tampons, dont un seul point lui paraît ressortir clairement, c’est qu’ungarese et l’Afrique par-dessus le marché, il y a du louche là-dessous. Lukács peut lui raconter tout ce qu’il veut, on lui rend ses papiers et deux soldats dont les fusils à baïonnette rehaussent l’allure martiale le poussent rudement à l’intérieur d’un local ressemblant à un bureau, où un autre sergent à l’air mauvais lui aboie de vider entièrement ses poches et d’ouvrir son sac. Linge de rechange, nécessaire de rasage plus une boîte en bois rembourrée de paille, à l’intérieur un bocal à conserve vert à couvercle vissé, avec dedans, énorme et cuirassé, un scorpion dont on ne saurait discerner au premier coup d’œil s’il vit encore ou non. Il s’avère à l’examen qu’il est complètement sec, à son côté se trouve une petite étiquette en bois brun foncé, ce qui est écrit dessus est à peine lisible. Lukács sait d’avance qu’il va devoir recourir aux mots pratiqués en cette matière dans toutes les langues pour expliquer qu’il s’agit d’une espèce jusqu’ici totalement inconnue, Pandus regis berenicea, comme précisé sur la tablette de bois, et qu’il faut faire parvenir le spécimen au plus vite à Budapest, au Muséum National, à l’attention de monsignore professor Grünwald, tant que le maintiennent inaltéré l’air africain et les trois pouces de ce sable rouge dans lequel il repose si joliment, dissimulant quelques billets de banque anglais soigneusement roulés sous lui, suivant la suggestion du docteur Berg – un homme avisé n’ira pas fouiller là-dedans.
Ce n’est pas une question politique ni stratégique, pas même une histoire d’espionnage, mais une affaire scientifique ; Lukács relève la jambe droite de son pantalon de fine étoffe et, montrant tour à tour une tache de la taille d’une paume sur son mollet – un hématome congénital qui bleuit sous la peau – et le scorpion, il indique que celui-ci est vraiment deathly, morte morieris ajoute-t-il en latin pour achever de convaincre l’ensemble des douaniers et soldats réunis. Puis, en même temps qu’avec précaution, comme si le frottement exercé sur la tache lui faisait très mal, il relâche son pantalon, il tire de son revers un billet de banque anglais et le glisse dans la main de l’officier qui lui paraît le plus gradé. Mais, dans le brouhaha, personne ne fait déjà plus attention à lui, sans doute que tout le monde connaît une histoire de scorpion. Il faut rejouer la même comédie en allemand au col du Brenner et à la gare de Vienne, d’où aucun train ne partira pour Budapest avant longtemps, on ne peut pas même savoir s’il y en aura de nouveau un jour, reste à faire le trajet en charrette ou pedibus cum jambis, des moyens de transport toujours fiables. Seul un sergent hongrois du secteur de Sopron ne croit pas à son histoire. « Montre-moi donc ton autre jambe aussi, fiston ! » Le spectacle de la blessure infligée par le lion le radoucit néanmoins et, après une interminable conversation nocturne au cours de laquelle Lukács raconte toute sa vie, il se contente de conclure : « Moi, à ta place, je ne retournerais pas à Kolozsvár ». Lukács remballe dignement tous ses documents, ses deux photos et ses journaux anglais : il est parvenu jusqu’ici, alors il ne doit plus être trop loin du but. Il est vrai que Kolozsvár est à l’autre bout de la Hongrie mais qu’est-ce que cette distance comparée aux savanes infinies de l’Afrique ou aux vagues immenses de l’Océan indien ? Il ne sait pas encore que Kolozsvár n’est plus en Hongrie, pire encore, qu’il n’y a plus de Kolozsvár, c’est tout juste si la Hongrie existe encore ; ou peut-être le sait-il déjà mais ne l’appréhende pas, n’a pas le temps de se préoccuper de savoir s’il s’agit d’une situation provisoire, d’un accident de l’histoire comme il y en a déjà eu tant d’autres, ou s’il en sera ainsi pour toujours. Il s’efforce de se fondre dans la foule où, parmi les gens qui trimballent des paquets, des valises, des baluchons, des sacs, il ne suscite aucune attention. Portant casques de poilus, bandes molletières et fusils français à baïonnette, les soldats roumains en faction à l’entrée du hall canalisent la foule à coups de gueule. Parfois ils font signe à quelqu’un de s’approcher, le regardent au fond des yeux, prononcent quelques mots dans leur langue mais ne retiennent personne plus longuement. Lukács n’a pas même été inquiété par deux détectives habillés en civil, qui peut-être attendent leur homme ou sont à l’affût de dames et messieurs de meilleure apparence, pas du genre à voyager en troisième classe dans l’omnibus non chauffé de Sopron, lequel a roulé cahin-caha, multipliant les arrêts dans des gares où un voyageur descendait parfois au prix d’une lutte serrée ou montait au prix d’une lutte encore plus serrée. Il y a eu toujours plus de monde, toujours plus de bagages, des gens crasseux, essoufflés, encombrés, qui se volaient aussitôt dans les plumes, comme si le voisin direct était responsable de la misère du monde, parce que sinon qui d’autre ? À qui demander des comptes ? Lukács s’est senti de plus en plus petit, s’est recroquevillé dans son coin à côté de la fenêtre fendillée. D’un côté il savait gré à la foule de réchauffer le wagon mais de l’autre il redoutait que quelqu’un ne lui sonne les cloches pour s’être arrogé le droit de rester assis jusqu’à la fin, alors que tant de gens voyageaient debout, certains même sur le toit et les tampons. En Afrique il avait pris l’habitude de ne s’étonner de rien mais là-bas, dans les premiers temps surtout et encore longtemps après, il ne saisissait rien du cours des choses, ou seulement très peu. Ici il a vite fait de comprendre quelque chose d’essentiel, se forçant à rester indifférent quand bien même ce qu’il vivait et percevait appelait une interprétation tragique : c’est qu’ici maintenant tout le monde déteste tout le monde, sans que l’on puisse dire précisément pourquoi. Passion, amertume, sacrifice entretiennent chez les gens cette haine dont le motif véritable ne peut être ni la guerre perdue, ni l’indigence, ni le déclin, car de la misère et des humiliations, il en avait vu pas mal en Afrique mais de cette haine qui s’enflamme toute seule, nulle part. Au début, il a juste été perturbé puis la crainte que ce pays ne soit effectivement pas celui qu’il avait quitté avec son père a tourné à l’obsession. Du reste Papa non plus n’avait pas su dire que, s’il fallait s’en aller à temps bien loin d’ici, c’était parce qu’un jour se libérerait l’insondable et injustifiable haine, comme si soudain la face la plus sombre de l’âme humaine prenait le dessus ou était attirée à la surface par la lumière sans qu’on puisse rien y faire, tel l’esprit qu’on a laissé s’échapper de la bouteille et qui veut maintenant régner, peu importe sur qui et sur quoi pourvu qu’il ait quelqu’un à torturer et accabler – au moins une fois.