Transcription de l’interview réalisée dans le cadre des ateliers de traduction de l’Institut Liszt en 2021.
 Née en Hongrie, arrivée en France à l’âge de quinze mois, vous avez eu une éducation française, mais le hongrois, j’imagine, était parlé à la maison pendant votre enfance. Quel était votre rapport à la langue de vos parents à l’époque ? Et comment a-t-il évolué au fil du temps ?
Née en Hongrie, arrivée en France à l’âge de quinze mois, vous avez eu une éducation française, mais le hongrois, j’imagine, était parlé à la maison pendant votre enfance. Quel était votre rapport à la langue de vos parents à l’époque ? Et comment a-t-il évolué au fil du temps ?
Je n’ai jamais vraiment réfléchi à la question. Ça s’est fait d’une façon assez naturelle… Je ne savais pas parler français jusqu’à l’âge de quatre ans. La tentative de mes parents de me mettre à l’école maternelle s’est soldée par un échec terrible parce que je ne comprenais pas un mot de français et je ne comprenais pas un mot de ce que tous les autres petits enfants qui me tournaient autour me disaient. Ils n’arrêtaient pas de répéter quelques mots. J’avais de grandes nattes, ils me tiraient les cheveux et je ne pouvais rien faire. Je suis rentrée en pleurs chez moi, chez mes parents. Je leur ai dit que je ne comprenais pas ce qu’ils me disaient. Les trois mots que j’ai bien retenus étaient : « T’es bête, Catherine. » (rires) Cette entrée dans la langue française m’a marquée pour le reste de ma vie ! Alors, le rapport que j’ai gardé avec la langue hongroise. D’abord, je l’ai parlée avec mes parents, toujours, jusqu’à leur mort, en fait. C’était un hongrois un peu abâtardi comme toutes les langues qui sont parlées par des exilés, qui sont assimilés, avec beaucoup de mots français. Quand je ne savais plus un mot en hongrois, je le disais en français. J’utilisais par exemple le verbe français conjugué à la hongroise. Il y avait des accommodements comme ça. Sinon, je crois que c’est une chance de pouvoir être bilingue jeune, parce que ça nous ouvre la porte à toutes les autres langues. C’était aussi quelque chose de privé, ce n’est qu’avec ma famille que je pouvais parler comme ça. C’était un langage familial. Chacun a un langage familial. Même quand on parle français en France. Pour moi c’était les histoires que racontaient ma mère et ma grand-mère. C’est quelque chose qui m’a beaucoup entourée quand j’étais petite. Je crois que ça m’a poursuivie aussi après.
Vous avez eu une première carrière en tant que professeure d’anglais. La traduction littéraire est venue après. Comment s’est opéré ce changement de cap ?
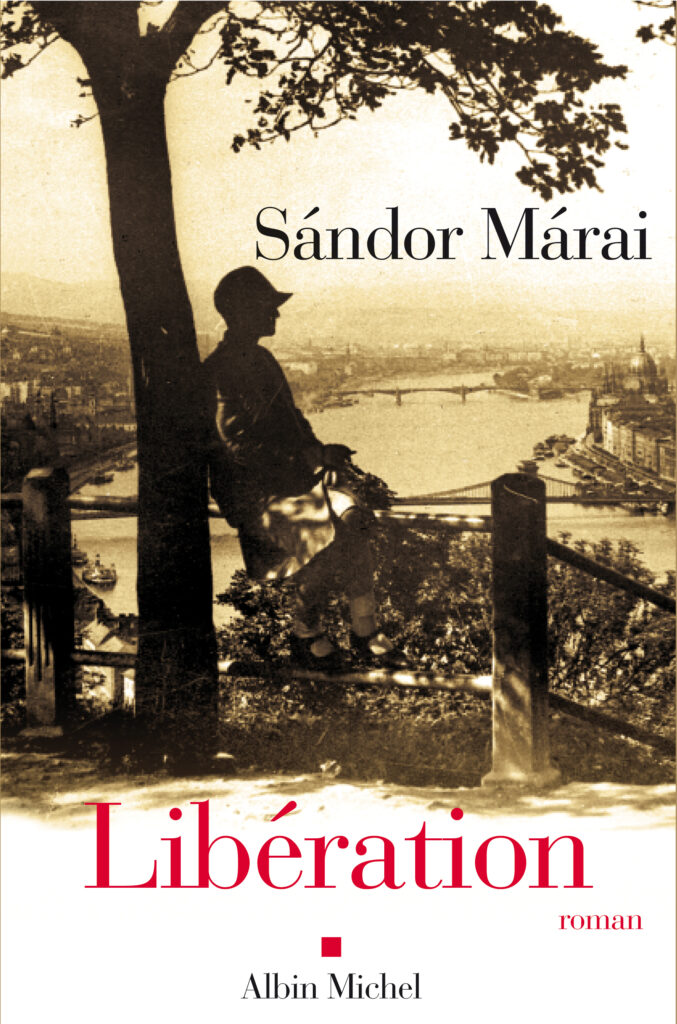 Comme une espèce d’évidence. J’ai été prof d’anglais pendant très longtemps, jusqu’à ma retraite. Je suis restée très longtemps dans un lycée en banlieue parisienne et, à la fin, je n’en pouvais plus. La traduction que je faisais en cours, ce n’était pas de la traduction, si, c’était toujours des extraits de textes, on n’a jamais traduit de livre avec des élèves et je me suis rendu compte de la frustration que ça peut apporter, de traduire des petits bouts. Excusez-moi (rires) c’est aussi ce que je vous ai fait faire ! C’est assez frustrant car il n’y a pas de continuité. La raison pour laquelle j’ai fait de la traduction ? Il y a plusieurs raisons, d’abord, parce que à un moment donné j’ai vécu avec un monsieur qui traduisait des livres, donc, j’ai un peu travaillé avec lui et ensuite j’ai voulu réapprendre le hongrois parce que je ne connaissais rien à la grammaire, je ne connaissais rien à l’histoire, ni à la littérature parce que les livres hongrois que j’avais lus avant, je les lisais en traduction française. Je lisais beaucoup plus de livres en anglais. Quand je suis partie à la retraite, j’avais soixante ans, pile. Je me suis dit, mais qu’est-ce que je vais faire ? J’ai travaillé toute ma vie et j’avais déjà réfléchi à ça au moment où j’avais pris quelques cours à l’Inalco pendant deux ans. J’ai eu envie de commencer à faire des traductions. Et puis, à l’époque, il y avait déjà un concours de traduction à l’Institut hongrois qui était assez bien doté. C’était une bourse conséquente. J’ai eu le premier prix en 2000. On m’a payé le voyage pour aller à Budapest et donné de l’argent en plus. Il y avait plus d’argent à cette époque-là pour la littérature ! Je suis allée à Budapest où j’ai encore un petit peu de famille, et puis avec l’argent de la bourse j’ai acheté des bouquins. J’ai acheté un peu par hasard, je dois dire, Szabadulás de Márai. Je ne connaissais pas particulièrement Márai. J’avais lu un livre de lui, Les confessions d’un bourgeois, en français. C’était un livre de mon père. J’ai lu Szabadulás : c’était l’histoire du siège de Budapest telle que me la racontait ma mère. C’était incroyable. Il y avait beaucoup de ressemblances. Et puis, je me suis dit, bon, je vais le traduire. Comme ça. Je n’avais pas la moindre idée de qui, de quoi, de ce qu’il fallait faire mais je connaissais un peu M. Kassai, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, c’est lui qui traduisait Márai pour la maison d’édition Albin Michel. Je l’ai contacté et je lui ai dit mais comment faire ? (rires) Il m’a aidée, il m’a mis vraiment le pied à l’étrier. Ce qui est relativement rare car dans le monde de la traduction, chacun a son pré carré. Il m’a introduite chez Albin Michel. C’était en 2001, je crois. J’ai contacté donc l’éditrice qui était en charge de la traduction à l’époque, Dominique Autrand. Elle m’a dit, oui, on va sans doute le publier mais on ne sait pas quand. Alors si vous le faites, vous le faites à vos risques et périls. Alors je l’ai fait parce que j’avais envie de le faire. C’était avant que je prenne ma retraite. J’étais tranquille, j’avais un salaire.. J’ai pris ma retraite et j’étais un peu paniquée : il fallait que je fasse quelque chose ! Et j’ai eu une chance incroyable : je suis partie en juin 2006 de l’Éducation nationale et, en septembre, Dominique Autrand m’a téléphoné pour m’annoncer que voilà, on allait le publier. J’avais déjà envoyé ma traduction chez Albin Michel. C’est comme ça que ma « glorieuse » carrière a débuté. Mais bon, j’ai eu de la chance. Et ce premier livre que j’ai traduit a eu une très bonne presse. Je ne sais pas trop pourquoi.
Comme une espèce d’évidence. J’ai été prof d’anglais pendant très longtemps, jusqu’à ma retraite. Je suis restée très longtemps dans un lycée en banlieue parisienne et, à la fin, je n’en pouvais plus. La traduction que je faisais en cours, ce n’était pas de la traduction, si, c’était toujours des extraits de textes, on n’a jamais traduit de livre avec des élèves et je me suis rendu compte de la frustration que ça peut apporter, de traduire des petits bouts. Excusez-moi (rires) c’est aussi ce que je vous ai fait faire ! C’est assez frustrant car il n’y a pas de continuité. La raison pour laquelle j’ai fait de la traduction ? Il y a plusieurs raisons, d’abord, parce que à un moment donné j’ai vécu avec un monsieur qui traduisait des livres, donc, j’ai un peu travaillé avec lui et ensuite j’ai voulu réapprendre le hongrois parce que je ne connaissais rien à la grammaire, je ne connaissais rien à l’histoire, ni à la littérature parce que les livres hongrois que j’avais lus avant, je les lisais en traduction française. Je lisais beaucoup plus de livres en anglais. Quand je suis partie à la retraite, j’avais soixante ans, pile. Je me suis dit, mais qu’est-ce que je vais faire ? J’ai travaillé toute ma vie et j’avais déjà réfléchi à ça au moment où j’avais pris quelques cours à l’Inalco pendant deux ans. J’ai eu envie de commencer à faire des traductions. Et puis, à l’époque, il y avait déjà un concours de traduction à l’Institut hongrois qui était assez bien doté. C’était une bourse conséquente. J’ai eu le premier prix en 2000. On m’a payé le voyage pour aller à Budapest et donné de l’argent en plus. Il y avait plus d’argent à cette époque-là pour la littérature ! Je suis allée à Budapest où j’ai encore un petit peu de famille, et puis avec l’argent de la bourse j’ai acheté des bouquins. J’ai acheté un peu par hasard, je dois dire, Szabadulás de Márai. Je ne connaissais pas particulièrement Márai. J’avais lu un livre de lui, Les confessions d’un bourgeois, en français. C’était un livre de mon père. J’ai lu Szabadulás : c’était l’histoire du siège de Budapest telle que me la racontait ma mère. C’était incroyable. Il y avait beaucoup de ressemblances. Et puis, je me suis dit, bon, je vais le traduire. Comme ça. Je n’avais pas la moindre idée de qui, de quoi, de ce qu’il fallait faire mais je connaissais un peu M. Kassai, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, c’est lui qui traduisait Márai pour la maison d’édition Albin Michel. Je l’ai contacté et je lui ai dit mais comment faire ? (rires) Il m’a aidée, il m’a mis vraiment le pied à l’étrier. Ce qui est relativement rare car dans le monde de la traduction, chacun a son pré carré. Il m’a introduite chez Albin Michel. C’était en 2001, je crois. J’ai contacté donc l’éditrice qui était en charge de la traduction à l’époque, Dominique Autrand. Elle m’a dit, oui, on va sans doute le publier mais on ne sait pas quand. Alors si vous le faites, vous le faites à vos risques et périls. Alors je l’ai fait parce que j’avais envie de le faire. C’était avant que je prenne ma retraite. J’étais tranquille, j’avais un salaire.. J’ai pris ma retraite et j’étais un peu paniquée : il fallait que je fasse quelque chose ! Et j’ai eu une chance incroyable : je suis partie en juin 2006 de l’Éducation nationale et, en septembre, Dominique Autrand m’a téléphoné pour m’annoncer que voilà, on allait le publier. J’avais déjà envoyé ma traduction chez Albin Michel. C’est comme ça que ma « glorieuse » carrière a débuté. Mais bon, j’ai eu de la chance. Et ce premier livre que j’ai traduit a eu une très bonne presse. Je ne sais pas trop pourquoi.
Peut-être que c’était bien traduit…
C’est ce que tout le monde m’a dit mais bon… C’est comme ça que j’ai pu continuer de travailler avec Albin Michel. Jusqu’à aujourd’hui. C’est comme ça que je suis devenue un peu la traductrice officielle de Márai sans avoir rien demandé, sans aucune intention.
Vous dites dans une interview que lorsque votre père a découvert Mémoires de Hongrie de Márai « il l’a lu d’une traite, la nuit, tant ce livre l’a bouleversé : ce n’était pas seulement son histoire, mais sa façon de voir »(1). Il est intéressant que vous soyez devenue plus tard la voix française de cet auteur. Vous vous sentez également proche de Márai ?
 C’est la question qu’il ne fallait pas poser (rires). Márai ne devait pas être quelqu’un de facile. On le sent dans ce qu’il écrit. Je ne suis pas du tout d’accord avec ses idées politiques par exemple. Mais j’étais tellement contente de pouvoir travailler de façon régulière. Et c’est vrai que petit à petit, j’ai traduit des livres de Márai. Je crois que je ne me serais sans doute pas entendue avec Márai. Mais petit à petit, on entre dans un style. Surtout quand j’ai traduit le Journal, je me suis rapprochée de l’homme Márai, pas de l’écrivain dont j’avais fait connaissance au fur et à mesure que je traduisais ses livres. Je suis devenue familière avec son style, avec son vocabulaire, avec sa « petite musique ». Mais l’homme Márai, j’ai toujours éprouvé une certaine réticence. Je crois que je ne le connaissais pas bien avant de commencer à traduire le Journal… Vous savez qu’il y a 18 volumes. Le Journal commence en 1943-1948, des années très dures pour le monde entier. Et c’est là que j’ai commencé à l’apprécier vraiment. Parce que, d’abord, il a été très courageux pendant la guerre, très discret aussi sur la façon dont il a sauvé quand-même pas mal de gens, des Juifs notamment, mais pas seulement. Lui-même a été mis en danger, les fascistes, les nazis hongrois, les Croix fléchées l’ont recherché. Ce n’était pas simple, en plus il avait des réactions plutôt impartiales par rapport aux Soviétiques, à l’armée soviétique. Il a été très intéressé par eux. Il n’a pas eu peur d’eux…
C’est la question qu’il ne fallait pas poser (rires). Márai ne devait pas être quelqu’un de facile. On le sent dans ce qu’il écrit. Je ne suis pas du tout d’accord avec ses idées politiques par exemple. Mais j’étais tellement contente de pouvoir travailler de façon régulière. Et c’est vrai que petit à petit, j’ai traduit des livres de Márai. Je crois que je ne me serais sans doute pas entendue avec Márai. Mais petit à petit, on entre dans un style. Surtout quand j’ai traduit le Journal, je me suis rapprochée de l’homme Márai, pas de l’écrivain dont j’avais fait connaissance au fur et à mesure que je traduisais ses livres. Je suis devenue familière avec son style, avec son vocabulaire, avec sa « petite musique ». Mais l’homme Márai, j’ai toujours éprouvé une certaine réticence. Je crois que je ne le connaissais pas bien avant de commencer à traduire le Journal… Vous savez qu’il y a 18 volumes. Le Journal commence en 1943-1948, des années très dures pour le monde entier. Et c’est là que j’ai commencé à l’apprécier vraiment. Parce que, d’abord, il a été très courageux pendant la guerre, très discret aussi sur la façon dont il a sauvé quand-même pas mal de gens, des Juifs notamment, mais pas seulement. Lui-même a été mis en danger, les fascistes, les nazis hongrois, les Croix fléchées l’ont recherché. Ce n’était pas simple, en plus il avait des réactions plutôt impartiales par rapport aux Soviétiques, à l’armée soviétique. Il a été très intéressé par eux. Il n’a pas eu peur d’eux…
Le deuxième tome du Journal de Márai Les années d’exil 1949-1967 vient de paraître. Dans le cas de cette publication votre rôle dépasse largement celui de la traductrice : en collaboration avec András Kányádi vous effectuez une sélection à partir du journal complet. D’une certaine manière, vous forgez l’image de Márai l’homme en France. Cette responsabilité, comment vous la vivez ?
C’est très lourd. (rires) Je suis très consciente de ça. C’est une énorme responsabilité, c’est vrai. Heureusement qu’on est deux avec András Kányádi pour la sélection des extraits… On ne choisit pas n’importe quel extrait. Nous sommes d’ailleurs généralement d’accord sur les choix. Je commence la traduction du 3ème et dernier tome sous peu. C’est presque comme réécrire un nouveau livre, d’une certaine façon. Ce n’est pas très modeste de dire ça mais c’est un peu une réalité.
Je crois que vous privilégiez un peu l’aspect humain de Márai.
Oui, c’est ce qui m’intéresse plus, mais bon, je ne veux surtout pas faire une hagiographie, ça ne l’est pas, ce n’est pas mon but, et ce n’est pas honnête non plus par rapport au lecteur. En ce qui concerne le choix des extraits, András est peut-être plus rigoureux que moi et peut-être moins porté que moi sur le côté relationnel (avec le fils, avec l’épouse, avec les gens). Si nous nous étions écoutés, on aurait des bouquins qui feraient le double de pages ! Mais effectivement, cette collaboration a été très très précieuse. J’ai traduit beaucoup de pages que finalement j’ai éliminées : j’avais besoin de pouvoir tailler dans la masse. Quand on en a trop, on peut en enlever. Et on a moins de scrupules. C’est un travail assez difficile mais j’ai adoré le faire, vraiment.
Je sais que c’est vous qui avez convaincu Albin Michel de publier L’Affaire Eszter Solymosi(2) de Krúdy. Pourquoi était-il important pour vous de faire connaître cet ouvrage ? Comment voyez-vous les possibilités du traducteur de faire accepter leurs choix aux maisons d’édition ?
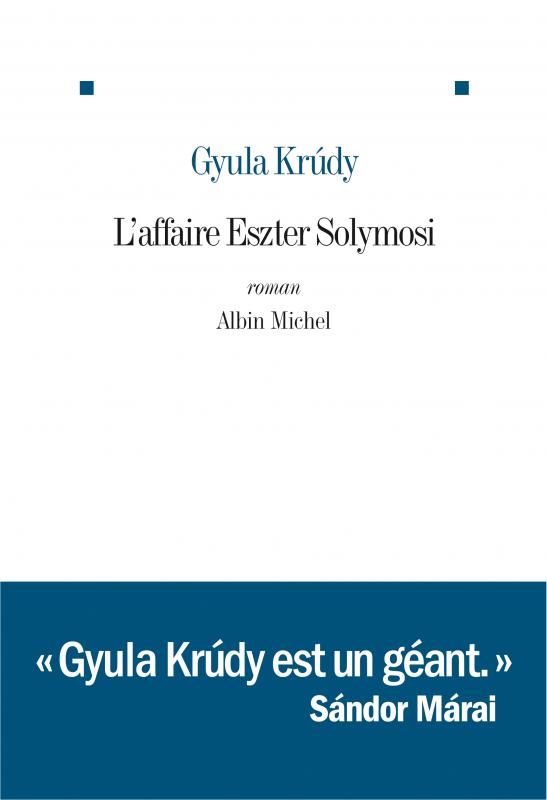 Je vais répondre d’abord à votre dernière question. La plupart du temps, ce sont les traducteurs qui exercent une influence sur le choix des livres à traduire. Comment voulez-vous qu’un éditeur connaisse toutes les langues ? Nous lisons la langue, je ne sais pas, hongroise, indonésienne… Il faut nous faire confiance. Oui, c’est une question de confiance entre le traducteur et l’éditeur. Par ailleurs, il y a aussi des agents littéraires qui eux aussi proposent des livres.
Je vais répondre d’abord à votre dernière question. La plupart du temps, ce sont les traducteurs qui exercent une influence sur le choix des livres à traduire. Comment voulez-vous qu’un éditeur connaisse toutes les langues ? Nous lisons la langue, je ne sais pas, hongroise, indonésienne… Il faut nous faire confiance. Oui, c’est une question de confiance entre le traducteur et l’éditeur. Par ailleurs, il y a aussi des agents littéraires qui eux aussi proposent des livres.
En ce qui concerne L’Affaire Eszter Solymosi, Je l’ai fait d’abord parce que j’apprécie beaucoup Krúdy, qui est plus « difficile à placer » que Márai, plus facile à lire pour les Français. Dans l’Affaire Eszter Solymosi, Krúdy s’est inspiré d’un événement historique, un procès fondé sur une accusation mensongère, bâtie de toutes pièces, qui a été démontée ensuite à l’issue d’un procès retentissant. Il s’agit de la disparition d’une petite fille, 13-14 ans, Eszter Solymosi. Dans le Nyírség, au nord-est de la Hongrie. D’où est originaire Krúdy. La petite jeune fille a disparu le jour de Pâques ou la veille de Pâques. Il se trouve que cette année-là, en 1882, il y avait une coïncidence entre la Pâque juive et Pâque chrétienne. Les Juifs ont été accusés de sa disparition. On a bien retrouvé un cadavre mais… je ne vous raconte pas toute l’histoire sinon on n’aura pas le temps de faire l’atelier ! C’est une enquête mais avec le style de Krúdy, avec la poésie de Krúdy, la faconde, la richesse de Krúdy, c’est un livre magnifique. Je l’ai traduit sans contrat. J’en ai parlé à mon éditrice, Dominique Autrand, qui a dit que ça avait l’air intéressant. Elle m’a beaucoup soutenue. Et à un moment donné, j’avais traduit à peu près les trois quarts du livre, sans aucune certitude, quand des rumeurs ont circulé selon lesquelles il allait peut-être traduit ailleurs : le livre étant entré dans le domaine public, tout le monde était en droit de le traduire. J’en ai parlé à l’éditrice, qui a convaincu Albin Michel et c’est ainsi que j’ai eu un contrat. Et puis, si je l’ai traduit, ce livre, c’est parce qu’il est beau. Une raison suffisante.
Dans l’interview déjà citée, vous parlez des limites des dictionnaires bilingues et des avantages des « dictionnaires vivants », c’est-à-dire, des référents qui peuvent être un ami ou une amie magyarophone. Il ne vous manque pas l’échange avec l’auteur ? Je pense naturellement à Márai et à Krúdy.
Je ne suis sans doute pas la seule parmi les traducteurs. L’auteur me parle, qu’il soit mort ou vivant. Peut-être pas au début. Mais après… les mots qu’il utilise, le vocabulaire, un univers que je connais. Il y a quand-même un dialogue. Traduire c’est aussi rompre le silence entre l’auteur et le traducteur. Quand on entend le texte, on entend l’auteur. Là, je vais peut-être travailler avec l’auteur de Másik halál (Autre mort). C’est autre chose, c’est extrêmement agréable de communiquer avec lui, au téléphone pour l’instant. Cela dit, comme il parle et lit le français, il comprend aussi très bien les problèmes que je peux rencontrer. Je me suis rendu compte que c’est difficile, cette traduction que je vous ai donnée. Toutes mes excuses. Je vous trouve très courageux de l’avoir fait.
Pourquoi cet auteur ? Pourquoi ce roman ?
Il y a quelques années, je ne sais pas comment, je suis arrivé à lui. Je crois que je lisais un livre d’un auteur irlandais et j’ai regardé cet auteur sur internet et, à partir de là, je ne sais pas comment je suis arrivée à Barnás. Des hasards en fait. J’ai vu sa tête et sa tête m’a plu. (rires) Il a une très belle tête, un peu cabossée. Puis, j’ai regardé ce qu’il avait écrit. Une belle tête bien tourmentée, ça doit faire de bons livres. Je me suis procuré deux livres, Másik halál et A kilencedik et j’ai lu les deux. J’ai pu le rencontrer à Paris il y a quelques années. Il travaillait avec quelqu’un d’autre sur un autre livre. Là, je ne sais pas encore si cette traduction me reviendra, j’espère que oui.
J’ai l’impression qu’on partage une vision plutôt intuitive de l’acte de la traduction. La phrase attribuée au comédien Groucho Marx, « Dans la vie, j’ai des principes, et s’ils ne vous plaisent pas, j’en ai d’autres. » s’applique, à mon avis, parfaitement à la traduction. Est-ce que vous avez une théorie de la traduction qui fonctionne pour vous ?
Non. Ma seule théorie c’est de ne pas en avoir. Parce que je suis incapable de formuler une théorie. Pour moi, c’est très difficile, en fait, les théories. En revanche, je suis d’accord avec vous, je marche beaucoup à l’intuition. Mes intuitions, je m’en méfie parfois. Ce qui fait que je remets toujours mon travail sur le métier. Je travaille peut-être plus lentement que quelqu’un d’autre mais c’est comme ça que je travaille, je ne sais pas travailler autrement. Et bien que je n’aie pas de théorie, cela ne m’empêche pas de donner des conseils. Mais fondés sur ma pratique. Uniquement.
(2) Albin Michel, 2013. Traduit par Catherine Fay
Transcription de l’interview réalisée Gábor Orbán
dans le cadre de l’atelier de traduction du 3 décembre 2021
à la bibliothèque de l’Institut Liszt – Centre culturel hongrois





