Transcription de l’interview réalisée dans le cadre des ateliers de traduction de l’Institut Liszt en 2021.
 Vous dites dans une interview que votre rencontre avec le hongrois relevait un peu du hasard…
Vous dites dans une interview que votre rencontre avec le hongrois relevait un peu du hasard…
J’ai eu plusieurs vies : j’ai été enseignante, ensuite, j’ai fait un travail d’artisanat d’art. Rien à voir. J’ai travaillé pendant une dizaine d’années, et je suis arrivée à un moment où je commençais à m’ennuyer, j’avais envie de faire autre chose et comme j’adore les langues, j’ai décidé d’apprendre une langue tout en continuant de travailler. Je suis allée aux Langues O’(1) . Je ne voulais pas apprendre une langue trop courante, ni une langue trop exotique non plus. Je voulais apprendre la langue d’un pays où je pouvais me rendre facilement. Quand j’ai vu la liste… Il y a des étudiants de Langues O’ ici, je pense. Quand on reçoit la liste, on est un peu impressionné par le nombre des langues. Je me suis dit, je vais lire toutes les langues une fois et je relirai une deuxième fois en rayant toutes les langues qui me semblent trop. Mais quand je suis arrivée au H – hongrois, je me suis arrêtée et je me suis dit, c’est le hongrois. Ça correspondait à mes critères peut-être inconscients. Je ne connaissais rien du hongrois. J’avais quelques noms hongrois plutôt au niveau de la culture qui me fascinaient comme Béla Bartók. En fait, je crois que j’ai appris le hongrois à cause de Béla Bartók. Mais sans le savoir. Après, pendant l’été, puisqu’on s’inscrit en juin, je crois, après, il y eu tout l’été, donc j’ai fait des recherches et là, je me suis dit, mon Dieu… J’ai lu que c’était la langue la plus difficile du monde. En fait, j’ai appris facilement cette langue. Et là non plus, je ne sais pas trop pourquoi. C’est une langue que je ne trouve pas difficile, mais c’est une langue où on doit oublier sa propre langue. Mais après, si on arrive à oublier sa propre langue, c’est une langue logique, plus logique que le français : c’est une langue ludique et libre, c’est ça qui m’a beaucoup plu. Le français est moins ludique.
Pourquoi ? Parce que l’ordre des mots est beaucoup plus libre en hongrois ?
Oui, et il y a une logique. À un moment, j’ai enseigné un petit peu le hongrois surtout à des hommes d’affaires qui partaient à l’époque où il y avait plein de chefs d’entreprises qui partaient en Hongrie. Et j’ai été étonnée puisque je pensais que c’était une langue un peu littéraire… Moi, je suis plutôt littéraire. Je me souviens d’un monsieur, un polytechnicien typique. Le hongrois, il adorait. Par exemple, pour enseigner la possession en hongrois c’est compliqué, il ne faut surtout pas passer par le français mais lui, comme c’était un matheux, il suffisait de lui mettre « valakinek van valamije(2)» , c’est-à-dire comme une formule mathématique, Et hop. Incroyable. Donc, il y a une logique un peu mathématique. Et après, il y a une grande liberté de créativité. On peut créer des mots… Et même si on veut créer un mot par exemple, on connaît quand même, par exemple à partir d’un verbe créer un substantif… il y a une règle « -ság, -ség ». Vous pouvez écrire tout ce que vous voulez.
C’est un peu lego…
Oui c’est un peu lego. C’est ça le côté ludique. Je me souviens que la première fois où je suis allée en Hongrie, je ne parlais pas très très bien hongrois. Si je ne connaissais pas un mot, j’essayais de l’inventer et même si le mot n’existait pas, les Hongrois ne rigolaient pas. Ils acceptaient alors qu’en français la bravitude fait un scandale national. En hongrois la bravitude passerait très bien.
Je crois que votre première traduction publiée de Krasznahorkai est le résultat d’un défi lancé par votre professeur de hongrois…
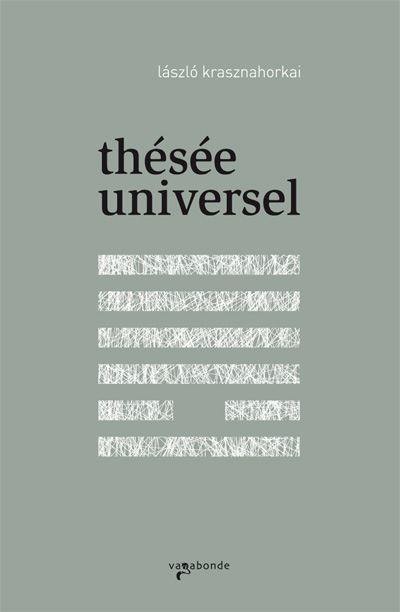 C’était Szende Tamás, un excellent professeur de hongrois. Il m’avait beaucoup encouragée. Il avait donc créé… non ce n’est pas lui qui l’a créé la maison d’édition In Fine mais il avait eu un très bon contact avec un éditeur français pour publier des textes hongrois et il a eu l’idée de cette grande anthologie de la littérature hongroise(3). Il avait donné des textes à traduire à beaucoup d’étudiants. Il m’avait donné deux textes. Ça m’ennuie de le dire mais je me suis beaucoup ennuyée. C’était des textes qui n’avait pas un grand intérêt littéraire. Et puis, ils étaient relativement faciles à traduire. C’était un peu des dialogues simples. Donc, j’étais un peu vexée. Je lui avais dit que ces textes étaient nuls, qu’ils n’étaient pas intéressants. Ça l’avait un peu énervé. Ce que je peux comprendre. Et du coup, un jour, peut-être dix jours après, il est venu avec 5-6 pages. Et puis il m’a dit, « ah, tu veux de la difficulté ? Tu veux de la littérature ? Tessék(4). (rires) J’ai tout de suite senti que c’était un très beau texte. Mais avec des passages… J’ai commencé à traduire et il y avait vraiment des passages, je n’y arrivais pas du tout. Chez Krasznahorkai, surtout ses premiers textes (c’était l’un des trois discours 5), des fois le sujet est là et pour trouver où se situe la suite… J’avais des amis hongrois et je leur demandais parfois de m’aider, et ils me disaient, bah non. Eux, ils ne comprenaient pas non plus. Et j’étais là, oh, mon Dieu. Et comme il y avait cette histoire de défi, je ne pouvais pas ne pas y arriver. C’est ça qui m’a beaucoup motivée. Je n’avais pas le droit d’aller le voir et lui dire, oui je me suis trompée. J’ai attendu donc d’être à Budapest et j’ai appelé Krasznahorkai. Il y avait deux-trois passages que sans lui, il était impossible de comprendre. J’ai eu un rendez-vous avec lui à Szentendre. Il y avait ces deux-trois morceaux de phrase. Je me rappellerai toujours. Il y avait un passage où je ne comprenais rien. Et alors, il m’explique et c’était pire. (rires) Et il dit « tu as compris ? » Et là, je dis « non ». Je n’osais pas dire que c’était pire. J’ai dit « non pas tout à fait ». Et il me réexplique une deuxième fois. Et je ne comprends toujours pas. Mais je ne vais quand même pas lui dire que je n’ai toujours pas compris, il va me prendre pour une dinde. Il me réexplique pour une troisième fois et me demande si j’ai compris. Et je réponds « oui ». (rires) Il me regarde et me dit « non ». (rires) Et là il me réexplique encore une fois. Là, j’ai vraiment compris. Il m’a donné toutes les clés. Il est toujours très… Ce qui est terrible, des fois il me dit ce qu’il veut dire mais il y a un décalage entre ce qu’il veut dire et la façon dont il l’exprime. Moi, ce que j’ai du mal parfois à comprendre, c’est la façon dont il l’énonce. Il me dit toujours tout.
C’était Szende Tamás, un excellent professeur de hongrois. Il m’avait beaucoup encouragée. Il avait donc créé… non ce n’est pas lui qui l’a créé la maison d’édition In Fine mais il avait eu un très bon contact avec un éditeur français pour publier des textes hongrois et il a eu l’idée de cette grande anthologie de la littérature hongroise(3). Il avait donné des textes à traduire à beaucoup d’étudiants. Il m’avait donné deux textes. Ça m’ennuie de le dire mais je me suis beaucoup ennuyée. C’était des textes qui n’avait pas un grand intérêt littéraire. Et puis, ils étaient relativement faciles à traduire. C’était un peu des dialogues simples. Donc, j’étais un peu vexée. Je lui avais dit que ces textes étaient nuls, qu’ils n’étaient pas intéressants. Ça l’avait un peu énervé. Ce que je peux comprendre. Et du coup, un jour, peut-être dix jours après, il est venu avec 5-6 pages. Et puis il m’a dit, « ah, tu veux de la difficulté ? Tu veux de la littérature ? Tessék(4). (rires) J’ai tout de suite senti que c’était un très beau texte. Mais avec des passages… J’ai commencé à traduire et il y avait vraiment des passages, je n’y arrivais pas du tout. Chez Krasznahorkai, surtout ses premiers textes (c’était l’un des trois discours 5), des fois le sujet est là et pour trouver où se situe la suite… J’avais des amis hongrois et je leur demandais parfois de m’aider, et ils me disaient, bah non. Eux, ils ne comprenaient pas non plus. Et j’étais là, oh, mon Dieu. Et comme il y avait cette histoire de défi, je ne pouvais pas ne pas y arriver. C’est ça qui m’a beaucoup motivée. Je n’avais pas le droit d’aller le voir et lui dire, oui je me suis trompée. J’ai attendu donc d’être à Budapest et j’ai appelé Krasznahorkai. Il y avait deux-trois passages que sans lui, il était impossible de comprendre. J’ai eu un rendez-vous avec lui à Szentendre. Il y avait ces deux-trois morceaux de phrase. Je me rappellerai toujours. Il y avait un passage où je ne comprenais rien. Et alors, il m’explique et c’était pire. (rires) Et il dit « tu as compris ? » Et là, je dis « non ». Je n’osais pas dire que c’était pire. J’ai dit « non pas tout à fait ». Et il me réexplique une deuxième fois. Et je ne comprends toujours pas. Mais je ne vais quand même pas lui dire que je n’ai toujours pas compris, il va me prendre pour une dinde. Il me réexplique pour une troisième fois et me demande si j’ai compris. Et je réponds « oui ». (rires) Il me regarde et me dit « non ». (rires) Et là il me réexplique encore une fois. Là, j’ai vraiment compris. Il m’a donné toutes les clés. Il est toujours très… Ce qui est terrible, des fois il me dit ce qu’il veut dire mais il y a un décalage entre ce qu’il veut dire et la façon dont il l’exprime. Moi, ce que j’ai du mal parfois à comprendre, c’est la façon dont il l’énonce. Il me dit toujours tout.
Vous dites quelque part que vous formez « un vieux couple » avec Krasznahorkai. Est-ce qu’il y a des scènes de ménage ?
Absolument. On a eu une rupture pendant deux-trois ans. Une vraie rupture.
C’était quoi la cause ?
Je ne vous le dirai pas.
Quand on vous interroge sur la traduction, les mots qui reviennent le plus souvent sont : phrase, rythme, musique, virgules. Vous mentionnez plus rarement le point-virgule mais je sais que vous avez une piètre opinion de ce signe de ponctuation. Pourquoi ?
Peut-être, mais pas d’une façon générale.
Pour Krasznahorkai.
Voilà. Le problème de Krasznahorkai c’est d’arriver à tenir la longueur de ses phrases et ces phrases sont souvent très musicales, très rythmés avec un rythme qui diffère d’ailleurs, il joue beaucoup. Krasznahorkai, il faut le lire à voix haute et quand on le lit à voix haute, le point-virgule à l’oral, c’est comme un point en fait. La voix tombe comme pour un point. Et on peut redémarrer une phrase avec un nouveau sujet or ce n’est pas ce qu’il fait lui.
Ce n’est pas une vraie solution.
Non. Pour moi, c’est ne pas oser mettre le point vu que lui ne met pas le point mais c’est comme mettre un point. Surtout à l’oral. Et pour moi, le défi c’est de toujours respecter la longueur de ses phrases. Puisque chez lui c’est un élément fondamental.
On dit souvent que la traduction est bonne si le travail du traducteur reste imperceptible. Vous avez gagné plusieurs prix dont le Grand prix de la Société des Gens de Lettres pour l’ensemble de votre œuvre. J’imagine que ces récompenses sont d’autant plus d’importants qu’ils récompensent un travail particulièrement exigeant mais presque toujours éclipsé par l’ombre de l’auteur.
Non, pas du tout. C’est très gratifiant de recevoir des prix et que son travail soit reconnu mais on reste au service d’un ou des auteurs. Il ne faut pas non plus renverser les rôles. Quand un livre de Krasznahorkai ou d’autres sort, je suis très curieuse, j’adore lire des critiques, j’y suis très sensible, mais des fois des critiques qui ne parlent pas du tout de moi me font plus plaisir que celles qui parlent de moi car elles parlent de l’écriture de Krasznahorkai et ils se rendent même pas compte qu’ils ne lisent pas Krasznahorkai. Pour moi, c’est vraiment encore plus élogieux même si ça ne parle pas de moi. Puisqu’ils parlent de l’écriture de Krasznahorkai. En fait, c’est la mienne. (rires) La mienne non, c’est la sienne… Ce qui m’a fait rire une fois : un critique parlait de l’art de la virgule chez Krasznahorkai. Là, c’était drôle, parce qu’il ne met pas du tout au même endroit les virgules en hongrois.
Alors c’est vous le « maître de la virgule ».
C’est ça. (rires)
Vous dites que la traduction de la poésie ne vous attire pas, car les sacrifices à faire sont trop nombreux. Je garde pourtant un très bon souvenir de votre traduction du concours de poésie dans un livre d’Ervin Lázár où le véritable défi consiste à transmettre des structures poétiques incongrues. Un exercice probablement plus difficile que traduire de bons poèmes…
C’est comme des jeux de mots. Par exemple, quand j’ai traduit la première partie d’Harmonia Cælestis(6), c’était terrible, tous les jeux de mots. Mais là, c’est Péter Esterházy qui participait, beaucoup. Disons, la poésie, je pense qu’il faut être poète. Je crois qu’il vaut mieux absorber les poèmes et les recréer carrément. C’est un autre poème de toute façon. Mais les romans de toute façon sont d’autres romans aussi.
Est-ce que vous pouvez nous parler de vos projets actuels de traduction ?
Je suis en train de traduire, et ça fait plus d’un an et j’ai beaucoup de mal à le finir, Le retour du baron de Krasznahorkai.
J’imagine que ça doit être volumineux déjà.
C’est ça. Je n’en peux plus. J’ai dit à Cambourakis que je ne voulais plus traduire de pavés. Parce qu’on ne voit jamais le bout. Et les phrases sont de plus en plus longues. (rires) Son dernier livre, je crois qu’il fait 300 pages et une phrase.
(1) Surnom affectif de l’Inalco (Institut national des langues et civilisations orientales)
(2) ‘Quelqu’un a quelque chose’
(3) Auteurs hongrois d’aujourd’hui, Anthologie dirigée et présentée par Thomas Szende, Éditions In Fine, 1996
(4) ‘Les voilà’
(5) Les trois discours ensemble ont paru sous le titre de Thésée universel (Vagabonde, 2011. Traduit par Joëlle Dufeuilly)
(6) Gallimard, 2001. Traduit par Joëlle Dufeuilly et Agnès Járfás
Transcription de l’interview réalisée par Gábor Orbán
dans le cadre de l’atelier de traduction du 12 novembre 2021
à la bibliothèque de l’Institut Liszt – Centre culturel hongrois





