András Kányádi sur le roman de Nándor Gion dont la sortie est prévue pour le 30 août
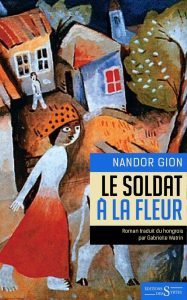 La tétralogie voïvodinoise, chef d’oeuvre de Nándor Gion, présente un intérêt particulier quant à la durée de l’élaboration : menée en deux temps, elle s’étale sur trois décennies marquées par la césure importante de la chute des états communistes. Les deux premières parties ont paru dans la Yougoslavie des années 1970 : Virágos katona (Soldat à la fleur, 1973) et Rózsaméz (Miel de rose, 1975), réunies sous le titre de Latroknak is játszott ; les deux dernières – Ez a nap a miénk (Ceci est notre jour, 1997) et Aranyat talált (Il a trouvé de l’or, 2002, posthume) – en Hongrie (1).
La tétralogie voïvodinoise, chef d’oeuvre de Nándor Gion, présente un intérêt particulier quant à la durée de l’élaboration : menée en deux temps, elle s’étale sur trois décennies marquées par la césure importante de la chute des états communistes. Les deux premières parties ont paru dans la Yougoslavie des années 1970 : Virágos katona (Soldat à la fleur, 1973) et Rózsaméz (Miel de rose, 1975), réunies sous le titre de Latroknak is játszott ; les deux dernières – Ez a nap a miénk (Ceci est notre jour, 1997) et Aranyat talált (Il a trouvé de l’or, 2002, posthume) – en Hongrie (1).
La pause qui sépare les deux vagues de sorties s’explique par la sensibilité politique du sujet des volumes tardifs : la reprise hongroise de la Bácska pendant la Seconde Guerre mondiale ainsi que la caricature du régime titiste à l’époque de sa consolidation. Gion recrée l’histoire d’une microrégion – le village de Szenttamás (Srbobran) en Voïvodine – à travers un demi-siècle, depuis l’Autriche-Hongrie à la République fédérative populaire de Yougoslavie, avec tous ses moments de rupture : les guerres et les changements politiques et territoriaux qui en résultent.
L’auteur qualifiait sa propre méthode de travail de « réalisme enrichi » (dúsított realizmus), faisant penser à un laboratoire scientifique où les personnages, colorés et amplifiés, deviennent porteurs de significations symboliques.
Cet alchimie d’écrivain a pour conséquence le repli de la documentation historique face à la représentation fictionnelle, voire symbolique de la réalité. Le Soldat à la fleur est un roman d’éducation qui se nourrit des souvenirs des grands-parents de l’auteur à l’aube du XXe siècle ; Miel de rose a tout d’un roman parabolique sur la cohésion communautaire de l’entre-deux-guerres ; Ceci est notre jour s’apparente à la ballade populaire teintée de western (!) dans la tourmente de la Seconde Guerre mondiale, alors que Il a trouvé de l’or se lit comme une parodie picaresque de roman policier à l’époque de la guerre froide. La chute dramatique des différents empires historiques entraîne des scénarios apocalyptiques, tandis que la connotation chrétienne du titre unificateur de la tétralogie suggère l’omniprésence du mythe christique.
Le village de Szenttamás est un lieu pluriethnique. Faisant d’abord partie du Royaume de Hongrie, dépeuplé à la suite de l’occupation ottomane, il est recolonisé au XVIIIe siècle par des Hongrois, Serbes et Allemands. L’identité ethnique moderne émerge dès la révolution hongroise de 1848 : la partie serbe du village, fidèle à la maison des Habsbourg, résiste longuement aux assauts de l’armée de Kossuth. Ce fait historique lui vaut un changement officiel de nom sous le règne du royaume slave : dès lors, Srbobran, c’est-à-dire la « défense des Serbes », apparaît comme hautement symbolique. Rattaché à la Hongrie en 1941, il redevient yougoslave après la guerre. Les épisodes guerriers y sont particulièrement sanglants : une bonne partie de la population hongroise et la quasi-totalité des Allemands deviennent victimes des massacres des partisans de Tito. La géographie conditionne la séparation ethnique : les Hongrois sont installés sur les berges de la Bácsér/Krivaïa, alors que les Serbes vivent autour du Canal François/Veliki kanal. Les Allemands, et les deux éternels marginaux centre-européens, Juifs et Tsiganes, font également partie du paysage où la mosaïque ethnique, doublée de la diversité sociale, influe sur les rapports humains au quotidien.
En proie à une monomanie, les héros vivent leur passion à l’extrême.
Le protagoniste, István Gallai Rojtos, s’acharne à découvrir le secret du « Soldat à la fleur », peint sur le calvaire de son village ; il passe ses journées à méditer sur la signification de cette figure, oeuvre d’un peintre naïf anonyme. Il se désintéresse d’événements historiques cruciaux et même les tranchées de guerre ne parviennent pas à le détourner de son obsession. Son meilleur ami, Ádám Török, est un voleur dont la seule véritable passion consiste à ramasser de l’or : en toute circonstance historique, il n’hésite pas à dépouiller, voire à tuer les riches pour enterrer les objets de valeur au pied du calvaire. C’est toujours l’enrichissement qui occupe l’esprit de Stephan Krebs, le meunier souabe, au point de prévaloir sur ses préjugés identitaires. Et même les personnages épisodiques s’illustrent par des obsessions : l’aristocrate János Váry est victime d’une manie de la grandeur historique de sa classe et ne cesse d’étaler sa prétendue supériorité au mépris de l’actualité.
Une des obsessions centrales du Soldat à la fleur est le jeu de cartes, plus particulièrement le vingt-et-un, cet ancêtre du blackjack des casinos. Les cartes fonctionnent comme des oracles, pouvant annoncer avenir radieux ou sort funeste. Initié par un maître né sous l’égide du vingt-et-un – le sept juillet, en tant que septième enfant de ses parents-, Gallai apprend à identifier les cartes à partir de leur dos. Cela lui permet de les manipuler à sa guise et d’en faire un outil de vengeance. Plus qu’un simple jeu de hasard, le vingt-et-un apparaît dans le roman à la fois comme emblème de la réussite et symbole du pouvoir. Mais à Szenttamás, le vingt-et-un se présente aussi comme un rite calendaire, ayant ses propres codes. Chaque année, à l’occasion de la fête de son prénom, l’aristocrate le plus riche des lieux, János Váry, risque sa fortune au jeu : il invite à son château des candidats aisés. Si l’accueil est affable, les adieux sont humiliants : venus dans l’espoir de s’enrichir, les candidats perdent leur pécule et sont mis à la porte sous les insultes du gagnant. L’assurance saturnienne du seigneur est le gage principal de sa victoire, nourrie aussi de la fébrilité de ses adversaires obnubilés par la perspective fabuleuse de la possession. En même temps, ces parties de cartes constituent une importante source de revenus dans un État où l’aristocratie bat en retraite devant la bourgeoisie montante et met tout en oeuvre pour rester en selle. C’est pourquoi Váry accepte tous les apports, qu’il s’agisse des numéraires du photographe serbe ou des briques du propriétaire de fabrique allemand. Dès lors, il ne s’agit plus d’une partie ordinaire de vingt-et-un, mais d’une bataille entre deux couches sociales dont l’enjeu consiste, d’un côté, à écarter définitivement la noblesse du pouvoir économique, et de l’autre côté, à maintenir sa position dans la hiérarchie de la domination.
Une autre obsession importante porte sur le sentiment national.
Les nationalités de la double monarchie caressent des rêves d’indépendance et se rebiffent contre la magyarisation tardive et grossière, menée par le gouvernement d’István Tisza.
Ainsi, les Serbes songent à un grand empire slave, tandis que beaucoup d’Allemands attendent l’avènement d’un grand empire germanique : on retrouve ici aussi bien les vues du radical Jaša Tomić que celles d’Adam Müller-Guttenbrun (2). Dans sa région pluriethnique, Váry se rend parfaitement compte de l’ambiance hostile à l’égard de la politique hongroise et ne peut que se moquer des tentatives imaginées dans la capitale de rapprocher dominants et dominés. L’aristocrate hongrois désabusé de l’époque a tout d’un illusionniste cynique qui, témoin de l’échec de l’État de droit, tire sa vengeance de l’humiliation verbale et arrondit sa fortune en exploitant le rêve de l’ascension sociale de ses concitoyens, quel que soit leur appartenance ethnique. Le chemin de la fraternité apparaît comme utopique, il n’y a que le sentier de guerre des identités nationales. De toute évidence, l’empire multinational hongrois est devenu illusoire.
Le narrateur du roman se rend jour après au jour sur la colline du village où se trouve l’église catholique pour y étudier le calvaire naïf, en particulier la figure représentant le « Soldat à la fleur ». Ce légionnaire dont le harnais est surmontée d’une fleur jaune, accompagne le Christ sur son chemin de croix et fouette le supplicié. Mais tout au long des événements représentés par l’artiste primitif, le soldat a l’air d’être ailleurs ; sa maladresse le distingue de la foule assoiffée de sang. Le narrateur finit par percer le secret de l’anomalie: la cruelle mission ne peut affecter le Romain parce qu’il est heureux dans son monde. Le message transmis au spectateur devient alors symbolique pour le lecteur : en conservant la liberté intérieure, l’être humain est capable d’atteindre le bonheur, malgré les événements tragiques de son milieu. La soustraction au massacre n’est pas facile : le narrateur lui-même part à la guerre, et devient l’exécutant, comme le soldat du calvaire, des ordres de ses supérieurs. Mais, comme son modèle pictural, il arrive toujours à garder ses distances avec le pouvoir destructeur.
Un mot encore sur l’intertextualité des personnages. Dans le Soldat à la fleur, l’héritage littéraire des classiques hongrois est omniprésent. Ainsi, Váry s’apparente aux seigneurs originaux de Kálmán Mikszáth aussi bien par le don de maintenir l’illusion des temps passés que par son acharnement anti-bourgeois. Donquichottesque comme Pongrácz dans Le Siège de Beszterce, qui suspend le temps dans son château médiéval, impitoyable comme Görgey dans La Ville noire, qui n’hésite pas à abattre son ennemi pour des broutilles, il épouse aussi les méthodes du méchant Döbrögi auquel le narrateur, à l’instar d’un Ludas Matyi, a hâte de donner une leçon. Gallai a tout d’un petit berger rusé, indiqué aussi par son surnom, qui triomphe peu à peu de toutes les difficultés de la vie. Dès lors, un autre célèbre héros littéraire hongrois se dessine: le berger de Tamási, Ábel. Cette dernière parenté s’ancre aussi dans la condition spécifique de l’existence minoritaire: les deux personnages picaresques se trouvent confrontés depuis leur enfance à l’altérite et sont adeptes du dialogue avec le dangereux autre. La mosaïque voïvodinoise brille, dans la belle traduction de Gabrielle Watrin, de tout son éclat.
(1) Virágos katona, Újvidék-Novi Sad, Forum, 1973; Latroknak is játszott, Forum, 1976; Ez a nap a miénk, Budapest, Osiris, 1997; Aranyat talált a paru en feuilleton, dans la revue Forrás, Kecskemét. La trilogie Latroknak is játszott a vu le jour du vivant de l’auteur aux éd. Osiris (en 1999); la tétralogie, sous le même titre, aux. éd. Noran, à Budapest, (2007).
(2) Jaša Tomić (1856-1922), journaliste et homme politique serbe, fondateur du Parti Radical (Radikalna Stranka), s’est illustré par un nationalisme serbe militant pour l’union de la Voïvodine avec le Royaume des Serbes. Adam Müller-Guttenbrunn (1852-1923), écrivain et journaliste souabe, président de l’union des écrivains austro-allemands, a milité pour les droits de la minorité allemande du Royaume de Hongrie.
András Kányádi





