Transcription de l’interview réalisée dans le cadre des ateliers de traduction littéraire de l’Institut Liszt en 2022.
Vos débuts de traductrice ont été marqués par la poésie. Vous avez traduit, entre autres, les poèmes d’Endre Kukorelly[1] et András Imreh[2]. Comment êtes-vous devenue traductrice du hongrois et pourquoi la poésie a-t-elle été relayée par la prose ?
 Merci pour cette question et pour votre invitation. Mes remerciements ont à voir avec cette question parce que j’ai moi-même découvert la traduction grâce à des formats de ce genre, des ateliers. Ce n’est pas toujours facile de parler de traduction, les travaux théoriques sur ces questions sont passionnants, mais c’est aussi quelque chose qu’on apprend beaucoup en faisant. J’ai commencé à traduire parce que je m’intéressais à la langue et à la littérature contemporaines et à des auteurs qui entraient dans le champ de mes recherches en littérature comparée, mais qui n’étaient pas encore traduits. Après avoir participé à un concours de traduction, j’ai eu la chance de pousser une première fois la porte de la maison des traducteurs à Balatonfüred où j’ai participé à un séminaire animé par Agnès Járfás, la traductrice d’Esterházy entre autres, qui tout en nous faisant travailler sur des textes, transmettait beaucoup de sa manière à elle d’aborder ses auteurs, sa pratique de la traduction. Ensuite, la traduction poétique est venue d’un intérêt personnel pour ce genre, et puis aussi parce que, dans la traduction poétique il y a toute l’essence de la traduction, c’est là qu’on touche le plus aux limites du traduisible. C’est sans doute en traduisant de la poésie qu’on en apprend le plus sur les propriétés les plus singulières de la langue source, et c’est elle en même temps qui demande le plus d’inventivité dans la forme, de connaissances aussi dans la langue cible. Ce travail-là, j’ai eu le plaisir et la chance, pour Kukorelly, (mais aussi, pour une anthologie regroupant par exemple Borbély Szilárd, Bódis Kriszta, Erdős Virág, Térey János, Szabó T. Anna, etc.)[3], de le faire en binôme, avec une personne qui s’appelle Anna Bálint, à qui je dois beaucoup et qui n’est malheureusement plus de ce monde mais avec qui nous avons travaillé à deux comme une espèce de super-cerveau de traducteur, à la fois bilingue et foncièrement divisé. J’envie ceux qui traduisent à deux pour cette possibilité de dialogue permanent, je ne l’ai pas, mais cela a été extrêmement formateur pour moi de travailler dans cette configuration-là, sur des auteurs contemporains en particulier qui réfléchissent dans le texte même au fonctionnement du langage.
Merci pour cette question et pour votre invitation. Mes remerciements ont à voir avec cette question parce que j’ai moi-même découvert la traduction grâce à des formats de ce genre, des ateliers. Ce n’est pas toujours facile de parler de traduction, les travaux théoriques sur ces questions sont passionnants, mais c’est aussi quelque chose qu’on apprend beaucoup en faisant. J’ai commencé à traduire parce que je m’intéressais à la langue et à la littérature contemporaines et à des auteurs qui entraient dans le champ de mes recherches en littérature comparée, mais qui n’étaient pas encore traduits. Après avoir participé à un concours de traduction, j’ai eu la chance de pousser une première fois la porte de la maison des traducteurs à Balatonfüred où j’ai participé à un séminaire animé par Agnès Járfás, la traductrice d’Esterházy entre autres, qui tout en nous faisant travailler sur des textes, transmettait beaucoup de sa manière à elle d’aborder ses auteurs, sa pratique de la traduction. Ensuite, la traduction poétique est venue d’un intérêt personnel pour ce genre, et puis aussi parce que, dans la traduction poétique il y a toute l’essence de la traduction, c’est là qu’on touche le plus aux limites du traduisible. C’est sans doute en traduisant de la poésie qu’on en apprend le plus sur les propriétés les plus singulières de la langue source, et c’est elle en même temps qui demande le plus d’inventivité dans la forme, de connaissances aussi dans la langue cible. Ce travail-là, j’ai eu le plaisir et la chance, pour Kukorelly, (mais aussi, pour une anthologie regroupant par exemple Borbély Szilárd, Bódis Kriszta, Erdős Virág, Térey János, Szabó T. Anna, etc.)[3], de le faire en binôme, avec une personne qui s’appelle Anna Bálint, à qui je dois beaucoup et qui n’est malheureusement plus de ce monde mais avec qui nous avons travaillé à deux comme une espèce de super-cerveau de traducteur, à la fois bilingue et foncièrement divisé. J’envie ceux qui traduisent à deux pour cette possibilité de dialogue permanent, je ne l’ai pas, mais cela a été extrêmement formateur pour moi de travailler dans cette configuration-là, sur des auteurs contemporains en particulier qui réfléchissent dans le texte même au fonctionnement du langage.
Les raisons pour lesquelles je traduis plus de prose maintenant sont surtout éditoriales, je traduis toujours de la poésie, par intérêt personnel.
Vous avez été récompensée par le prix Nicole Bagarry-Karatson en 2010 pour Précipice (Szakadék) et L’Histoire d’une solitude (Egy magány története) de Milán Füst. Ce dernier, je crois, a un lien indéniable avec L’Histoire de ma femme, le roman le plus célèbre de l’écrivain dernièrement porté à l’écran par Ildikó Enyedi, avec Léa Seydoux, entre autres. Pourquoi ces deux romans brefs ? Et comment avez-vous abordé la langue de Füst dont Esterházy disait qu’elle était à la fois « naturelle et ostensiblement construite, aux accents ciselés, bien à lui, perpétuellement emphatique et nerveuse[4] » ?
 Merci pour le lien entre cette question et la précédente, qui explique aussi en partie le choix du texte que j’ai proposé pour l’atelier. Dès mes premières traductions de Füst, j’ai eu la chance de traduire des textes en prose avec une assez forte charge poétique, des textes en prose qui travaillent beaucoup dans et avec la langue et qui en termes de traduction posent des tas de questions. Donc, l’histoire de Füst, c’était les débuts de la maison d’édition Cambourakis qui commençait à s’organiser en collections consacrées à des littératures étrangères. Pour le hongrois, le choix des auteurs de la première moitié du 20e siècle, avec Nyugat, s’imposait. Je crois que Frédéric Cambourakis lui-même avait lu L’Histoire de ma femme, traduit en français déjà dans les années 50. L’Histoire d’une solitude est intéressante de ce point de vue, car c’est une sorte de condensé, écrit a posteriori de L’Histoire de ma femme avec une dimension plus ramassée, mais tout ce qui fait la beauté de la langue de Füst (le monologue intérieur, la digression, etc.). C’est drôle parce que ce n’est pas un brouillon de L’Histoire de ma femme, ce n’est pas une esquisse, plutôt une réécriture toujours obsessionnelle, mais plus fulgurante. C’est vrai que cette langue est assez théâtrale, très orale dans son vocabulaire et dans ses effets, plutôt heurtés, dissonants d’ailleurs, avec un usage de la ponctuation assez particulier, je crois que Füst lui-même faisait pas mal enrager ses éditeurs.
Merci pour le lien entre cette question et la précédente, qui explique aussi en partie le choix du texte que j’ai proposé pour l’atelier. Dès mes premières traductions de Füst, j’ai eu la chance de traduire des textes en prose avec une assez forte charge poétique, des textes en prose qui travaillent beaucoup dans et avec la langue et qui en termes de traduction posent des tas de questions. Donc, l’histoire de Füst, c’était les débuts de la maison d’édition Cambourakis qui commençait à s’organiser en collections consacrées à des littératures étrangères. Pour le hongrois, le choix des auteurs de la première moitié du 20e siècle, avec Nyugat, s’imposait. Je crois que Frédéric Cambourakis lui-même avait lu L’Histoire de ma femme, traduit en français déjà dans les années 50. L’Histoire d’une solitude est intéressante de ce point de vue, car c’est une sorte de condensé, écrit a posteriori de L’Histoire de ma femme avec une dimension plus ramassée, mais tout ce qui fait la beauté de la langue de Füst (le monologue intérieur, la digression, etc.). C’est drôle parce que ce n’est pas un brouillon de L’Histoire de ma femme, ce n’est pas une esquisse, plutôt une réécriture toujours obsessionnelle, mais plus fulgurante. C’est vrai que cette langue est assez théâtrale, très orale dans son vocabulaire et dans ses effets, plutôt heurtés, dissonants d’ailleurs, avec un usage de la ponctuation assez particulier, je crois que Füst lui-même faisait pas mal enrager ses éditeurs.
Vous êtes la traductrice du roman d’Ádám Bodor, Les Oiseaux de Verhovina, joyau de la littérature hongroise contemporaine que les Éditions Cambourakis viennent de rééditer en version poche. Je me souviens qu’au moment de la parution du livre (en 2016), j’ai ressenti une jalousie profonde en lisant la critique d’Alice Zeniter dans Le Monde. Elle a cité votre nom à maintes reprises et dans des termes les plus élogieux : « Le texte que livre ici Sophie Aude échappe à toutes les maladresses que crée l’écart entre les deux langues : il est beau, poétique, drôle et il est fluide. » Dites-moi au moins que c’était un travail gigantesque.
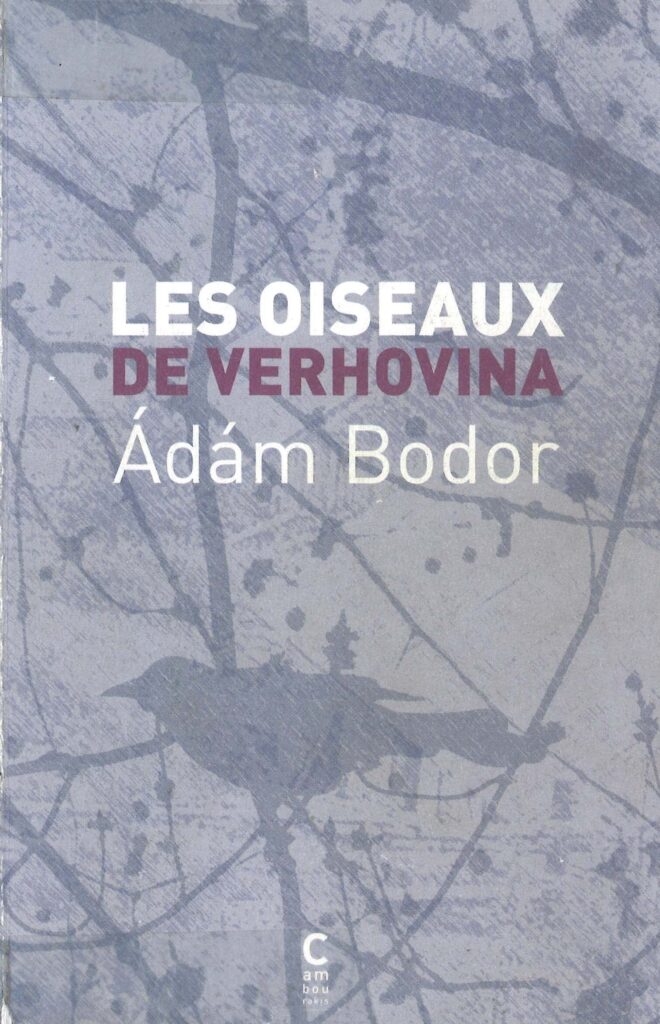 Oui. (rires) Un travail intense en tout cas. Bodor est sans doute l’un des premiers auteurs contemporains que j’ai voulu traduire. Ses deux premiers romans l’avaient déjà été, par deux traducteurs différents. Il y a vraiment beaucoup de distances à franchir pour qu’un texte hongrois arrive jusqu’à une oreille française. La réception est d’autant plus difficile quand un auteur apparaît avec un livre isolé, détaché de son œuvre. Cambourakis a racheté les droits des deux romans précédemment traduits, et republié La Vallée de Sinistra et La Visite de l’archevêque, tout ça chez le même éditeur, c’est une bonne chose en termes de visibilité et de cohérence, d’originalité d’une œuvre. Traduire Les Oiseaux de Verhovina a aussi été un très grand plaisir car il s’agit là encore d’une prose très dense, très travaillée, très belle. Cette traduction en particulier demandait de se plonger dans une langue et dans un espace plus ou moins identifiable, à la fois proche et lointain, et donc de recréer ce jeu de distances, en même temps que sa dimension fictionnelle, anti-utopique, et celle de l’humour noir, à travers un nombre incalculable de questionnements et de choix lexicaux, stylistiques.
Oui. (rires) Un travail intense en tout cas. Bodor est sans doute l’un des premiers auteurs contemporains que j’ai voulu traduire. Ses deux premiers romans l’avaient déjà été, par deux traducteurs différents. Il y a vraiment beaucoup de distances à franchir pour qu’un texte hongrois arrive jusqu’à une oreille française. La réception est d’autant plus difficile quand un auteur apparaît avec un livre isolé, détaché de son œuvre. Cambourakis a racheté les droits des deux romans précédemment traduits, et republié La Vallée de Sinistra et La Visite de l’archevêque, tout ça chez le même éditeur, c’est une bonne chose en termes de visibilité et de cohérence, d’originalité d’une œuvre. Traduire Les Oiseaux de Verhovina a aussi été un très grand plaisir car il s’agit là encore d’une prose très dense, très travaillée, très belle. Cette traduction en particulier demandait de se plonger dans une langue et dans un espace plus ou moins identifiable, à la fois proche et lointain, et donc de recréer ce jeu de distances, en même temps que sa dimension fictionnelle, anti-utopique, et celle de l’humour noir, à travers un nombre incalculable de questionnements et de choix lexicaux, stylistiques.
Selon Christina Virágh, traductrice allemande des Histoires parallèles de Nádas « […] ce que l’auteur observe et décrit avec précision, tout cela est aisé à traduire tant techniquement qu’esthétiquement. Le mot adéquat au bon endroit se justifie lui-même, même s’il est obscène, et trouve facilement son équivalent dans l’autre langue »[5] Vous avez travaillé sur la version française du même roman de Nádas aux côtés de Marc Martin et vous traduisez actuellement Világló részletek[6], œuvre autobiographique de l’écrivain hongrois. Qu’est-ce que vous inspirent les mots de sa traductrice allemande ? J’ai l’impression qu’elle idéalise un peu son travail…
Je ne sais pas. (rires) Les mondes culturels hongrois et allemand sont peut-être plus proches et offrent peut-être, linguistiquement aussi, plus de correspondances. Moi, je ne trouve rien d’évident dans la langue de Nádas, même si sa prose est sans effet spectaculaire, elle est également très construite aussi bien à un niveau extrêmement fin de détails sonores, rythmiques, lexicaux, que dans les grandes lignes, dans les volumes importants de ses longs textes. En ce qui me concerne, je sens moins une évidence qu’une exigence dans la place de chaque mot et dans la construction de l’ensemble, dans la manière dont une idée ou un mot arrive à la fin d’une phrase très longue par exemple, ou lorsqu’on retrouve parfois à 300 pages de distance un motif qu’on aurait pu penser anecdotique à sa première occurrence. Traduire ce texte demande, entre autres, une attention très active à la manière dont le texte se déroule.
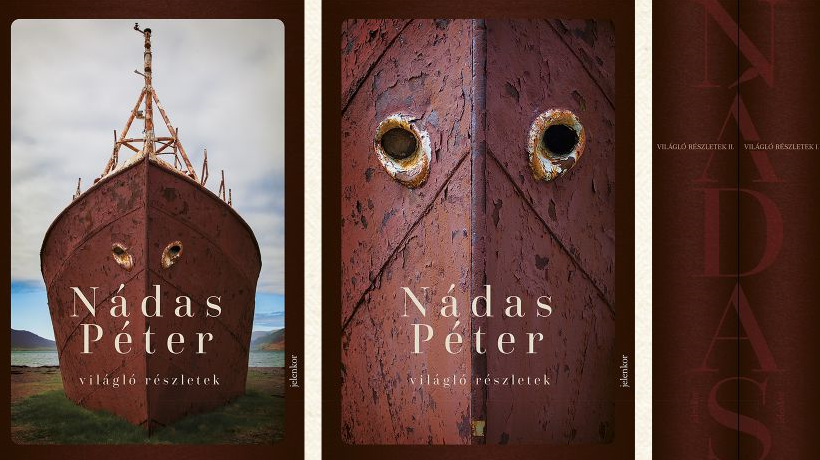 Ce texte fait combien de pages ?
Ce texte fait combien de pages ?
Világló részletek compte environ 1200 pages dans l’édition hongroise, en deux volumes. Je ne suis pas encore tout fait à la moitié du texte.
Votre dernière traduction en date, Teréz, ou la mémoire du corps de Eszter Molnár T. a eu un accueil très favorable en France (articles dans Lire, Libération, etc.). C’est loin d’être évident pour un premier roman dont l’autrice, biologiste de formation, est peu connue du grand public, même en Hongrie. Comment expliquez-vous ce succès surprenant ?
Le fait que la publication de cette traduction ait eu des échos dans la presse doit beaucoup à l’éditeur, Actes Sud en l’occurrence. J’avais eu la chance de bénéficier d’une subvention pour la traduction d’une cinquantaine de pages de ce livre, qui permet de solliciter des éditeurs pour un projet dont ils peuvent lire un extrait substantiel. Cet extrait, je l’ai envoyé à plusieurs maisons d’édition et à ma grande surprise, Actes Sud l’a accepté et a publié le texte dans une collection qui s’appelle Un endroit où aller, qui regroupe des textes un peu inhabituels dans leur forme. Et je pense que celui-ci y avait bien sa place, avec son principe de construction très original, la place qu’il fait aux langues étrangères, ses espèces d’entrées lexicales, ses collages.
Vous avez proposé de travailler sur une nouvelle de Zsófia Bán, Keep in touch. Ce texte complexe qu’on soupçonne autobiographique n’échappe pas au concept du recueil dont il fait partie[7] : selon l’hebdomadaire Magyar Narancs[8], toutes les nouvelles du livre partent d’une image ou réduisent la réalité à une image. Pourriez-vous dire quelques mots sur l’autrice et les raisons de votre choix ?
Je n’ai encore jamais traduit de textes de Zsófia Bán. Je l’ai connue avec son essai de 2016, Turul és dínó, sur le rôle des images et leur instrumentalisation dans les mémoires collectives, et tout un regard critique sur la société et la politique hongroises actuelles. Et puis je suis récemment tombée, dans un livre de Nádas intitulé Rokon lelkek, sur quelques pages consacrées à Bán Zsófia qui m’ont donné envie de reprendre son recueil, où elle s’intéresse à plusieurs motifs également chers à Nádas et qu’on retrouve en particulier dans le texte que je suis en train de traduire, la mémoire, le lien entre les images et le langage dans le processus de remémoration, son écriture, le rapport entre les images fixes et les images animées. On voit se dérouler dans ce texte de Zsófia Bán un film tiré d’archives familiales, qui est le point de départ de l’écriture. Pour l’atelier, ce texte m’a aussi semblé formellement intéressant, à la limite, là encore, de la prose poétique. Il réfléchit le processus d’écriture, de mémoire, à travers les images, en interrogeant par ailleurs le rapport entre les langues, entre différentes langues à l’intérieur d’un même texte. Toutes les langues sont traversées par d’autres langues, j’aime particulièrement les écritures qui jouent avec ça, la question étant de savoir comment la traduction, qui est un passage supplémentaire d’une langue à une autre, intègre ce jeu, le transmet. Il m’a semblé que ce texte offrait une manière très belle et très intéressante de se confronter à ces questions.
[1] Endre Kukorelly, Je flânerai un peu moins, Action poétique éditions, 2008 (Trad. Anna Balint et Sophie Aude)
[2] Trois poètes hongrois. Krisztina Tóth, János Lackfi, András Imreh, Éd. du Murmure, 2009
[3] Traductions réunies dans Action Poétique, n° 187, « Hongrie : nouveaux poètes », Ivry-sur-Seine, 2007
[4] Préface de Péter Esterházy, Milán Füst, L’histoire d’une solitude, Cambourakis, 2007
[5] Christina Virágh, A könyv, a szerzője, az akantusz és a fordító = Párhuzamos olvasókönyv, Pécs, 2012, dir. Gábor Csordás
[6] Jelenkor, 2017
[7] Amikor még csak az állatok éltek, Magvető, 2012
[8] Czinki Ferenc, Bán Zsófia: Amikor még csak az állatok éltek, Magyar Narancs, 14 mars 2013
Interview par Gábor Orbán
(Transcription de l’interview réalisée dans le cadre de l’atelier de traduction littéraire de l’Institut Liszt le 25 novembre 2022 )





