Interview avec Nina Yargekov, auteur du roman Double nationalité (P. O. L., 2016)
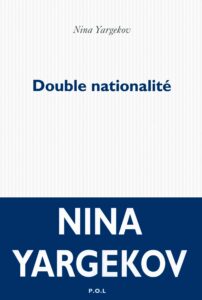 « Ce gros livre est un grand livre », nous rassure Bruno Frappat dans La Croix. Pourtant, à première vue, il peut paraître intimidant avec ses 684 pages. Quelle a été la réaction de votre éditeur en découvrant le manuscrit ? On vit à l’âge d’or des tweets…
« Ce gros livre est un grand livre », nous rassure Bruno Frappat dans La Croix. Pourtant, à première vue, il peut paraître intimidant avec ses 684 pages. Quelle a été la réaction de votre éditeur en découvrant le manuscrit ? On vit à l’âge d’or des tweets…
Le livre a pris du volume progressivement. Au début, je prévoyais 300 pages, puis 400, puis 500… Mon éditeur l’a lu au fur et à mesure et n’a compris je crois qu’à la fin qu’il serait si gros. Mais cela ne lui a pas posé de problème, c’est le texte qui l’intéressait. Les lecteurs me disent d’une part que le livre se lit plutôt facilement, et d’autre part, qu’ils apprécient de passer un temps relativement long en compagnie d’un texte.
L’utilisation de la deuxième personne du pluriel pour la narration est un choix particulier. En hongrois, il serait voué à l’échec à cause de l’ambiguïté formelle entre le vouvoiement et la troisième personne du singulier.
Oui, mais en hongrois, on traduirait par « tu ». Par la deuxième personne du singulier.
C’est une bonne proposition.
Il faudrait regarder comment a été traduit La Modification de Butor. Mais à mon avis, il serait logique de traduire par la deuxième personne du singulier.
C’est probablement le traducteur qui parle mais pendant la lecture, je ne cessais d’y voir une preuve supplémentaire du caractère irréconciliable des deux langues, des deux cultures.
Je suis aussi traductrice, dans d’autres domaines que la littérature, où la question se pose certes différemment, mais je ne suis pas d’accord avec l’idée de l’intraduisible. C’est ce que je pensais aussi autrefois mais j’ai changé d’avis. Oui, certaines choses sont plus percutantes dans une langue que dans l’autre, mais j’estime néanmoins que tout est traduisible. On peut toujours transposer le sens, l’intention, même si ce n’est pas toujours possible de le faire au niveau du mot ou de l’expression.
En annexe de votre roman, vous publiez un superbe « Manuel de yazige à l’usage des francophones » qui aurait sans doute beaucoup plu à Jorge Luis Borges. Vous y définissez le yazige (le hongrois) comme une langue mathématique : « toutes les fantaisies sont autorisées du moment que le calcul est juste, l’idée de néologisme nous est parfaitement inconnue car la question n’est pas de savoir si les mots employés figurent dans le dictionnaire mais si le résultat mathématique est vrai ou faux. » Vous n’avez jamais été tentée d’écrire dans cette langue que « n’importe quel extraterrestre sain d’esprit choisirait d’apprendre plutôt » que le lutringeois (français) ?
Je crois que je n’ai pas le niveau mathématique pour écrire tout un roman en yazige. La Petite taupe pourrait peut-être y arriver, mais pas moi. C’est difficile.

En effectuant des recherches sur vous, on tombe sur des phrases énigmatiques comme « Nina Yargekov est née dans une commune de 29 660 habitants » ou « Nina Yargekov est née un 21 juillet, soit le même jour qu’Alexandre le Grand, mais 2334 années plus tard. » Ce qui m’intéresserait, c’est plutôt de savoir comment Nina Yargekov est née ? Je crois comprendre qu’avant de devenir écrivain, vous avez porté un autre nom.
Oui, Nina Yargekov est l’anagramme d’un autre nom.
Que je n’ai pas deviné…
Ce n’est pas une information à caractère public. Mais effectivement, j’ai fait le choix de changer de nom pour l’écriture. Déjà parce qu’entrer en littérature a été une étape très importante dans ma vie. Il y a eu une forme de recomposition identitaire. Or le choix de l’anagramme permet justement de dire : c’est moi et ce n’est pas moi. Puisque ce sont mes lettres, mais recomposées. Donc c’est moi autrement. Ensuite, mon autre nom sonne vraiment très hongrois et je ne voulais pas être « la Hongroise de service », je n’avais pas envie d’être réduite à cela. Surtout que mes deux premiers romans n’ont rien à voir avec cette histoire… Je savais que j’écrirais plus tard un livre sur ma double identité, mais je n’avais pas encore décidé si je nommerais le pays, tout était encore flou, je voulais garder la liberté de prendre cette décision plus tard.
Qui plus est, Nina Yargekov pourrait être un nom yazige. Dans Double nationalité, l’histoire commence en France et le pays d’origine de la narratrice s’appelle Yazigie. Ensuite, elle décide de s’installer en Yazigie, et quand elle arrive là-bas, elle atterrit en Hongrie tandis que la France devient la Lutringie. Donc la Yazigie est la Hongrie vue depuis la France et la Lutringie est la France vue depuis la Hongrie.
C’est une manière de dire qu’un pays n’est pas tout à fait le même quand on y est et quand on le regarde de loin, mais aussi de montrer que la double culture va de pair avec deux regards sur deux pays, ce qui fait quatre combinaisons : la France avec un regard français, la France avec un regard hongrois, la Hongrie avec un regard hongrois et la Hongrie avec un regard français.
Sans compter que les pays imaginaires donnent plus de liberté car je peux outrer mon récit sans m’entendre dire « ah ce n’est pas vrai », sans qu’il me soit reproché de ne pas respecter la vérité historique, etc.
Pourquoi commencer à écrire s’est révélé un grand changement identitaire pour vous ?
C’était il y a longtemps, il m’est donc difficile de restituer exactement le processus, mais je sais que pour moi il y avait un enjeu… J’étais totalement fébrile, comme si je jouais ma vie, c’était pour mon premier roman… Est-ce que c’est de la littérature ? Est-ce que j’ai le droit d’écrire et donc le droit de vivre ? Pourquoi je me suis investie autant, c’est difficile à dire. Je pourrais répondre sur le comment mais pas sur le pourquoi.
Claire Devarrieux a écrit dans Libération que vous transmettez comme personne le plaisir de l’interprétation simultanée. On a effectivement l’impression que les rares moments où la protagoniste, traductrice-interprète de son état, prend son envol et se sent en phase avec ses multiples identités, c’est quand elle exerce son métier. L’échec de son intégration à la vie hongroise est d’ailleurs marqué par un échec dans une mission d’interprétation. Assurer la transmission d’une langue à l’autre est une sorte de mission sacrée, probablement la seule chose (avec le végétarisme) qui ne soit jamais remise en question dans le roman.
Dans le livre, cette mission arrive à un moment où elle est heureuse, où elle se dit qu’elle est bilingue, biculturelle, bi- « plein de choses », et que c’est très bien comme ça, que c’est une richesse. Et cette mission d’interprétation se passe très bien car elle découvre que c’est un grand plaisir. Si j’ai choisi de placer cette scène à cet endroit, c’est parce que je voulais qu’au-delà du côté « ah, c’est génial d’être biculturelle et binationale », on la voit en action, en train de vivre cette double position, et qu’elle soit agissante, d’ailleurs c’est le seul moment où elle est assez active, où elle ne subit pas ce qu’il lui arrive. Effectivement, le plaisir qu’elle éprouve à naviguer entre les deux langues, comme vous dites, avec le végétarisme, ce sont les deux seules choses qui sont là tout au long du texte et qui ne sont pas remises en cause, mais je pense que pour elle… Comment dire, c’était une autre manière d’appréhender cette question de la double identité. Pour moi il était évident que l’interprétation aurait une place importante dans le texte.
J’ai l’impression que l’interprétation ce n’est pas seulement très bien parler deux langues, ce n’est pas une simple compétence linguistique. Même ceux qui ne connaissent pas grand-chose à l’interprétation savent que cette sorte de gymnastique linguistique nécessite un apprentissage permanent, indissociable de la notion de professionnalisme. Même si elle est épanouie dans cette activité, elle y est aussi complètement isolée. Parce qu’elle ne peut pas participer… C’est une sorte de no man’s land aussi.
Je pense que c’est aussi une sorte d’allégorie de sa situation : elle est à la fois celle qui fait le lien, elle est double, mais en même temps elle est très seule. Elle est dans une situation où elle ne peut pas exprimer ses émotions… Elle doit faire semblant que tout va bien et paraître toujours très professionnelle. Et surtout sa position est très singulière. Finalement, hormis les autres interprètes, personne ne peut réellement comprendre ce qu’elle vit.
J’ai cru comprendre que vous êtes ou vous étiez interprète. Vous continuez cette activité ?
Oui, oui. En ce moment assez peu car j’ai d’autres obligations. Cette scène n’est pas du tout une scène réelle mais elle inspirée d’une pratique réelle. Cela aurait été sans doute difficile à écrire si je n’avais pas d’expérience dans ce domaine.
En tous cas j’ai rarement expérimenté ce glissement…
Ce n’est pas toujours comme ça. Parfois, ça glisse moins…
Votre protagoniste se réfère volontiers aux encyclopédistes et l’approche méthodique qu’elle déploie pour analyser tous les pans de son appartenance linguistique et culturelle la rapproche de l’essai ou du plan dialectique français, tandis que sa langue loufoque, son humour décalé, son horreur du premier degré évoquent la littérature d’Europe centrale. Quelles sont vos influences littéraires ?
Je suis assez d’accord, et même, voici ce que je voulais exprimer dans ce livre, mais je crois que personne ne peut vraiment le comprendre : en fait, la narratrice écrit son journal sur un cahier qu’elle a acheté à Budapest et le livre publié est en langue française, donc le message subtil sous-jacent que je voulais transmettre était qu’on avait affaire à un cahier hongrois couvert de mots français, soit une substance hongroise mais une mise en forme française.
En effet, c’est assez subtil.
Je sais que personne ne songe à cela en lisant le livre mais c’est ce que j’avais en tête.
Donc vous assumez le double héritage.
Oui, c’est ça. J’ai une amie hongroise qui m’a dit, c’est fou, la structure, les parties, c’est tellement français, je ne m’en étais pas rendue compte en l’écrivant mais c’est vrai.
Thèses et antithèses ponctuent le texte en permanence.
C’est vrai. J’ai eu une première vie en tant qu’universitaire. En tant que sociologue. J’ai mené mes recherches en Hongrie mais j’ai été formée à l’université française, ce qui m’a façonné l’esprit. Et dans l’écriture, y compris littéraire, c’est une influence importante. La langue et la démarche académique françaises, l’importance de la dissertation m’ont sûrement fortement marquée. Et ensuite, je suis très nourrie de sciences sociales, de droit et de philosophie. Et sur le plan littéraire, effectivement j’aime beaucoup tout ce qui touche à l’humour absurde, cela ne vous étonnera pas. D’une manière générale, j’ai du mal avec les textes dépourvus d’humour. Je ne sais pas si cela répond à votre question ?
Vous pourriez mentionner des auteurs en particulier ?
Côté français, je citerais les écrivains de l’Oulipo, certes pas uniquement français mais très liés à la France. Ou par exemple, Italo Calvino. Je pourrais aussi ajouter Montaigne, la tradition humaniste à la française. Côté hongrois, ma culture littéraire est moins bonne, c’est évident. Il y a un déséquilibre. Mais par exemple, la poésie, quand j’étais enfant j’ai beaucoup lu de poésie hongroise qui me touchait beaucoup plus que la française. Des poètes classiques, Ady, Arany. Et Kosztolányi a joué un rôle considérable. Chez lui aussi, il y a des histoires de double. Sinon, un livre m’a énormément marquée, Epepe [roman de Ferenc Karinthy, Denoël, 2005], non pas pour l’humour assez peu présent mais parce que j’y ai retrouvé cette espèce de volonté d’épuiser complètement un sujet. Budai, le personnage principal, est dans une situation difficile et, pour s’en sortir, il tente tout ce qu’il est possible de tenter. Je peux également citer Esterházy, son goût pour l’intertextualité, procédé que j’ai beaucoup utilisé surtout dans mes livres précédents qui comportaient énormément de références cachées.
J’ai mentionné les encyclopédistes. Je ne sais pas si c’est l’interprète qui parle par la bouche de la protagoniste mais elle exprime une véritable boulimie de savoir. Tout peut être intéressant. Sa volonté de connaître le monde est manifeste. Ce n’est pas une question, non plus. Plutôt un constat.
Ce n’est pas propre à ce livre-là. Effectivement, j’éprouve une sorte de soif d’exhaustivité. Vous avez cité Borges tout à l’heure. J’ai oublié de le dire, mais il fait partie des auteurs qui m’ont influencée. La Bibliothèque de Babel, cette volonté de systématiser le monde, que la littérature mange le monde en entier. Dans ce livre-ci c’est peut-être moins flagrant, mais dans ma démarche d’écriture, c’est toujours très présent, cette volonté d’épuiser le sujet, cette exhaustivité systématique. D’où cela me vient, je ne sais pas.
Outre l’humour absurde, l’autodérision peut également évoquer l’Europe de l’Est.
Pour moi, ce n’était pas un programme que je me serais fixé, c’est ma manière de faire. En particulier lorsque j’aborde des thématiques comme celles de Double nationalité. Dire simplement que le racisme c’est mal ou que la double identité c’est compliqué ne nous avance pas beaucoup. Beaucoup a déjà été dit sur ce sujet.
Je ne voulais surtout pas d’un roman plaintif où l’héroïne se lamente sur la complexité de sa vie et la tristesse du monde. La dérision ou l’autodérision permettent d’exprimer les mêmes choses avec un regard décalé. Il m’est arrivé de réécrire certains passages que je trouvais trop geignards, je me disais « Il faut que tu te décales un peu ».
L’amnésie de la protagoniste donne lieu à une enquête minutieuse sur elle-même, une « auto-perquisition », un règlement de compte à la fois drôle et bouleversant avec les concepts identitaires romantiques, vestiges inconscients d’un autre siècle. Elle passe par plusieurs phases : « Au commencement, vous avez cherché à déterminer laquelle des deux filles était la vraie. L’une OU l’autre. Soit deux possibilités. Ensuite est apparue une troisième hypothèse, l’une ET l’autre. Mais vous avez oublié qu’il existait encore une autre option, une autre combinaison. À savoir que vous ne soyez NI l’une NI l’autre. » La fin du roman suggère qu’un binational n’en finit jamais de se débattre avec ces trois possibilités. Vous, vous en êtes où ?
Ce que vous évoquez résume la fin du roman. L’une des options manque parce qu’avant de commencer son enquête, au tout début du livre, elle pense qu’elle est une immigrée. À ce moment-là, elle ne sait pas encore qu’elle est née en France, elle se prend pour une exilée, elle a la nostalgie de son pays d’origine alors même qu’en réalité, elle a grandi en France. Se percevoir comme un étranger dans le pays où l’on vit, c’est une option aussi, cela fait partie des possibilités offertes aux personnes à la recherche d’une identité. En effet, plusieurs options leur sont offertes, ce qui implique une forme de liberté, mais laisse aussi toute latitude aux autres pour leur « coller des étiquettes ». Finalement, la situation de l’héroïne est assez simple par rapport à d’autres situations parfois beaucoup plus compliquées. Je pense qu’il est possible d’alterner au cours d’une vie, la réponse est un peu la somme de tout cela. Selon les moments, les lieux, les ressentis. En tous cas, c’est quelque chose de dynamique. Je voulais montrer dans le livre que toutes ces options pouvaient coexister, qu’il n’est pas obligatoire de rester enfermé dans l’une d’elles.
Et vous, vous en êtes où ?
Disons, pour moi, maintenant que j’ai écrit ce livre, je suis tranquille. La réponse est dans le livre. En ce moment, certains lecteurs me disent « ah, il faut absolument que tu lises ça, sur le même sujet ». Mais cela ne m’intéresse plus, ou plus exactement, j’ai beaucoup réfléchi à ces questions-là. À la fois sur le plan intellectuel et sur le plan personnel, parce que le livre a une dimension autobiographique. Mais maintenant je suis assez sereine. J’ai l’impression que j’ai exploré le sujet. Et si quelqu’un me pose la question classique, celle que l’on pose aux gens comme moi « où est-ce que tu te sens le plus chez toi ? » je lui réponds, lisez le livre, la réponse est là.
On se demande souvent comment la sonorité du hongrois est perçue par un étranger. J’ai l’impression que le livre apporte des réponses, fait sentir un peu cela. Déjà avec le nom Yazigie, je ne sais pas si le mot Hongrie sonne comme Yazigie, mais il doit y avoir des similitudes. Le mot recèle un peu d’exotisme peut-être. J’ai apprécié cette volonté de montrer un peu « l’autre ».
Telle était mon ambition. Je crois que c’était aussi le point de départ d’un projet que je nourrissais depuis longtemps. Mais l’une des raisons pour lesquelles je voulais écrire ce livre c’est que je sentais bien qu’en France, parfois, je regardais les Français comme une Française, et d’autres fois pas tout à fait. Et puis certaines choses m’agaçaient ou m’interrogeaient, et je savais bien que c’était lié à mes origines hongroises. Et réciproquement, en Hongrie.
Le motif de l’espionnage qui traverse le livre n’est pas fortuit, même si l’héroïne n’est en aucun cas une espionne. Le rôle d’interprète peut ressembler à celui d’un espion. Mais surtout, j’ai souvent eu cette sensation au sens où les Français peuvent penser que je suis 100 pour cent française et donc parler devant moi de l’Europe de l’Est, de la Hongrie ou des étrangers en général ou des immigrés.
Mes parents sont des immigrés, et parce que je suis blanche, que je n’ai pas d’accent, ils n’imaginent pas que cela me concerne directement. En Hongrie aussi, il m’est arrivé très souvent qu’on me parle des Français sans savoir que je suis née et que je vis en France. Du coup, j’ai eu la sensation d’accéder à des discours auxquels je n’aurais pas dû accéder. Si en France, j’avais précisé être hongroise ou d’origine hongroise, mes interlocuteurs auraient fait plus attention. En Hongrie aussi, je me suis retrouvée dans ce genre de situation, non pas volontairement, mais tout simplement parce que je ne me balade pas avec un écriteau sur le front « attention je suis née en France et en ce moment je suis en vacances en Hongrie ». Le livre est aussi le fruit de cette envie de faire quelque chose de toutes ces micro-expériences collectées au fil des années.
Votre pseudonyme me fait penser au Triptyque de l’Europe de l’Est de Krisztina Tóth. C’est une femme d’Europe de l’Est qui parle. Son nom pourrait être tout à fait hongrois mais le poète a préféré un nom assorti d’une sonorité moins spécifique, évoquant plutôt l’Europe de l’Est en général, à la manière d’Ádám Bodor dont les personnages portent souvent des noms mi-roumains, mi-hongrois.
C’était exactement mon idée lorsque j’ai choisi le nom. (Je n’aime pas le mot pseudonyme qui suppose le recours à un « faux ». C’est juste un autre nom. C’est un vrai nom, je lui ai donné une existence.) J’étais très attachée à l’idée de l’anagramme. J’ai pris les lettres et j’ai fait des tests. Ça me plaisait bien que ce soit un nom bizarre qui sonne de l’Est, sans pouvoir être vraiment situé avec précision. C’était exactement cette idée. C’était un nom yazige, un nom de là-bas, d’un petit pays lointain, difficile à identifier. Et ce qui m’amuse beaucoup, c’est que cela donne des indications sur le lecteur. Certains, les Français surtout, me font remarquer que Nina Yargekov ce n’est pas très hongrois, que cela les étonne puisque le livre laisse imaginer que je suis hongroise. Et puis d’autres ne se posent pas du tout la question. Alors cela m’amuse car cela dit quelque chose de l’interlocuteur.
Ma fille est trilingue et aime passionnément la Petite taupe [personnage d’une série télévisée d’animation tchèque] mais j’imagine que vous n’avez pas choisi pour cette raison le personnage de dessin animé tchèque comme animal fétiche et unique soutien du protagoniste dans sa recherche identitaire. Comment cette peluche a-t-elle atterri dans le roman ?
Au moment de construire l’histoire, j’essayais d’imaginer les choses de manière très concrète. J’ai visualisé un appartement, inspiré d’un endroit que j’avais habité, puis j’ai essayé d’imaginer les pièces. Dans la visite virtuelle que j’effectuais dans ma tête, je suis tombée sur une carte postale de la Petite taupe. Et là tout d’un coup, j’ai ressenti une émotion, et je me suis dit qu’il y avait quelque chose à faire avec la Petite taupe. Que cela pouvait rappeler son enfance à l’héroïne. Un dessin animé certes tchèque, mais ceux-ci bénéficiaient d’une diffusion plus large… L’idée m’est venue comme ça, comme une évidence. J’ai senti que la démarche ne devait pas être uniquement intellectuelle, cérébrale, que l’héroïne avait aussi une vie affective, surtout qu’avec les hommes cela ne se passait pas très bien. Cette émotion était pour moi logiquement liée à l’enfance. La Petite taupe est un souvenir d’enfance, mais c’est peut-être aussi un double de l’héroïne, la petite fille qu’elle avait été. Plusieurs interprétations sont possibles, le personnage est un peu magique, il revêt plusieurs dimensions.
Où vous vous situez dans la littérature contemporaine française ?
On me dit souvent qu’il est difficile de me situer. J’ai du mal moi aussi. J’ai participé récemment à une émission de radio et la journaliste a évoqué la possible émergence d’une littérature écrite en français mais porteuse d’un regard décalé, c’est-à-dire écrite par des auteurs possédant un lien, une histoire avec un pays étranger. Et il est vrai qu’à la rentrée littéraire de l’automne dernier, beaucoup de livres relevaient de cette catégorie. Par exemple, Leila Slimani, qui a eu le prix Goncourt, est franco-marocaine. Cette journaliste, Sylvie Tanette, évoquait également la naissance d’une école de littérature étrangère en français. Peut-être qu’il se passe effectivement quelque chose de cet ordre-là en ce moment, et dans ce cas je pourrais m’y reconnaître. Sinon, je ne sais pas trop. En tous cas, ma maison d’édition est un bon repère, j’aime globalement tout ce qui y est publié. C’est une maison qui a une cohérence. On parle parfois d’une « école POL » ou d’un « mouvement POL ». Donc on pourrait également me situer de ce côté-là.
Interview : Gábor Orbán
Photo : Hélène Bamberger





