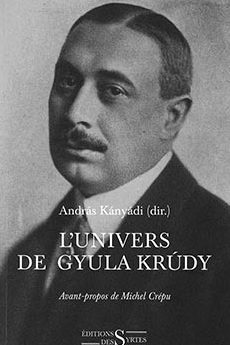Interview avec Agnès Járfás, traductrice littéraire, lauréate du grand prix de traduction de la ville d’Arles.
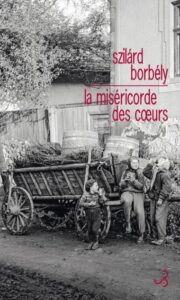 Le grand prix de traduction de la ville d’Arles vous a été attribué pour votre traduction du roman de Szilárd Borbély, La Miséricorde des cœurs (Christian Bourgois, 2015). Quel était votre premier sentiment en apprenant la nouvelle ?
Le grand prix de traduction de la ville d’Arles vous a été attribué pour votre traduction du roman de Szilárd Borbély, La Miséricorde des cœurs (Christian Bourgois, 2015). Quel était votre premier sentiment en apprenant la nouvelle ?
Une très grande joie. C’est une consécration. Surtout parce que ce prix a été attribué par mes pairs, les traducteurs de l’ATLAS [Association pour la promotion de la traduction littéraire]. À l’occasion de la remise du prix, j’ai appris qu’il y avait vingt livres en lice au premier tour, qu’il y en avait trois au second et que le jury m’a accordé le prix à l’unanimité. Cela m’a beaucoup touchée. J’espère que ce prix m’aidera à convaincre des éditeurs à publier les livres que je leur propose. Certains éditeurs, comme Dominique Bourgois, comptent beaucoup sur les traducteurs dans le choix des ouvrages. C’était le cas pour le livre d’Esterházy, Voyage au bout des seize mètres [Christian Bourgois, 2008].
Jusqu’à la parution de son premier et malheureusement unique roman, Szilárd Borbély était connu pour sa poésie en Hongrie. Sa prose dense, intense laisse deviner les qualités du « poète le plus prometteur et le plus perdu de la poésie hongroise » (Imre Kertész). L’un des critiques du livre (1) parle d’économie du langage « sujet, verbe, complément, pas de psychologie, des faits » et compare l’écriture de Borbély à celle d’Agota Kristof. Comment avez-vous abordé cette prose monolithique, indivisible comme les nombres premiers tant aimés par le jeune narrateur ?
C’est la voix d’un enfant qui a 4-5 ans au début du livre, 9-10 vers la fin et 17-18 à la toute fin du roman. C’est un langage, au premier abord, très simple. Or, il n’y a pas plus difficile que traduire des phrases brèves. Comme on dit en langage des traducteurs, le foisonnement du texte était assez grand. Prenons l’exemple du titre en hongrois Nincstelenek. « Nincs », c’est un verbe de non-existence en hongrois qui pourrait être traduit par « il n’y a pas ». C’est déjà très long par rapport à l’original. D’ailleurs, on était tenté de traduire le titre hongrois par « Les Dépossédés », mais dans le catalogue des éditions Christian Bourgois figurait déjà ce titre. L’enfant parle simplement, mais ce n’était pas finalement la simplicité du texte qui était le plus difficile. Le défi le plus grand consistait à trouver des mots pour des objets précis employés dans cette partie de la Hongrie, à cette époque. Les rendre visibles pour le lecteur français. Comme il était impensable de remplacer ce patois hongrois par tel ou tel patois français, j’ai fait des recherches. J’ai choisi donc des mots régionaux et, surtout, des mots archaïques. Un peu comme je l’ai déjà fait pour ma traduction d’Áron Tamási (2). Je prends un exemple : puliszka. Pour désigner un plat à base de farine de maïs, l’emploi de ce mot n’est pas limité au nord-est de la Hongrie, on s’en sert aussi dans la Transdanubie et dans la Grande Plaine, alors que c’est un mot originaire de la Transylvanie. Mais je ne pouvais pas le remplacer par « polenta », plat noble des Italiens, car il n’y a aucune commune mesure entre les deux plats. Finalement, j’ai trouvé « gaude ». C’est un mot archaïque qu’on employait à peu près pour le même plat en France. Traduire, c’est également une opportunité de sauver certains mots, de le remettre dans le courant.
La Miséricorde des cœurs nous plonge dans le quotidien d’une famille qui vit dans un petit village à l’extrême est de la Hongrie. Szilárd Borbély a passé son enfance dans cette région « éternellement pauvre » du pays dans les années 1960-1970. Ouvertement autobiographique, le livre ne manque pas d’une certaine « dimension ethnographique » et s’inscrit dans la grande tradition hongroise des « sociographies ». (L’œuvre de Gyula Illyés, Ceux des pusztas (3) est l’exemple probablement le plus connu de ce courant des années 1930, mêlant d’approches sociologique et littéraire.) Quelle est la différence entre le roman de Borbély et ces œuvres emblématiques sur le milieu rural hongrois ?
Le langage poétique et le désespoir de l’enfant qui veut échapper à cet univers. Le livre dépasse largement le cadre d’une sociographie. Même s’il fournit une description ethnographique extrêmement précise. Moi-même, je connais de nombreux objets mentionnés dans l’œuvre. Mais les Français de mon entourage me disaient : « mais oui, dans les Landes, mais oui, en Haute-Savoie, nous connaissons tel ou tel objet ». Donc ce monde est familier aux Français également. Dans une certaine mesure, ce que les Hongrois ont vécu pendant cette période-là, les Français l’ont connu pendant la guerre ou juste après. Finalement, l’univers des privations n’est pas exceptionnel. Ce qui est exceptionnel, c’est le drame humain que vivent ces personnages. Cette volonté désespérée de la mère et de son fils d’échapper à ce milieu pauvre, volonté doublée de la conscience d’être différent. C’est ce drame qui donne à ce texte une autre dimension. La tension est telle que le lecteur est happé par le drame. Le livre d’Illyés est également personnel, mais on n’y retrouve pas l’intensité dramatique de Borbély.
En revenant au côté ethnographique, il y quelques éléments dont le lecteur français ne se rend pas probablement compte. Dans cet univers, tout le monde a peur. On assiste à un bouleversement social…
Ce qui est extraordinaire dans ce roman, c’est que, par petites touches, à travers des objets, il nous livre l’histoire d’une famille, celle des personnes existantes et disparues de son entourage comme les membres de la communauté juive. Il y a un passage que beaucoup de critiques français ont relevé où les enfants mangent des tranches de pain au saindoux. Ils y mettent du sucre qui se trouve dans une boîte en fer-blanc. En racontant cette scène, l’enfant insiste sur le fait que, quand on se sert du sucre, il faut faire attention à la cuillère de bois, car son oncle l’a ramenée du Caucase. L’enfant ne comprend probablement pas ce que cela veut dire. Mais le lecteur oui. Au détour d’une phrase, Borbély parle de la déportation des Hongrois en Union soviétique. Le livre transmet, à travers des objets, une réalité que le lecteur hongrois comprend et qui était longtemps occultée. La déportation des Juifs est contée à travers des objets qu’on leur a volés. Il y a aussi une description magistrale des enterrements. C’est d’une vérité bouleversante pour tous ceux qui ont vécu en Hongrie dans les années 1960. Une description précise, d’une dramaturgie exceptionnelle. Cela pourrait faire partie d’une pièce de théâtre.
En revenant aux objets, il y a par exemple un livre avec des caractères bizarres. C’est probablement un livre liturgique juif…
Je pense que non. La mère ne parle pas hébreu. Le père est probablement d’origine juive, mais ce n’est pas sûr. Il y a un flottement. Un mystère. On dit qu’il est peut-être l’enfant naturel du dernier Juif du village. Je crois qu’il était tout simplement très proche d’eux, qu’il les a beaucoup aimés. Je suis persuadée que le livre en question est un livre de piété en lettres gothiques. C’était donc un livre hongrois, mais en lettres gothiques, que la mère pouvait lire, en le déchiffrant difficilement. On sait que la mère était très croyante, très pieuse. Elle essayait d’introduire ses enfants dans la religion. Elle priait avec eux. Quand l’institutrice leur rend visite, elle remarque tout de suite la présence d’un chandelier. À cette époque, jusqu’aux années 1970, on devait se méfier des visiteurs qui inspectaient les objets. Y compris les bibliothèques. Il fallait mettre les livres interdits au deuxième rang. Déjà pour leur religion, la famille se sentait différente. Parce que les grecs-catholiques sont minoritaires en Hongrie. Szilárd Borbély dit dans l’une de ses interviews qu’il aimait beaucoup la liturgie de cette religion et que, en assistant à une messe, il sentait la présence de sa mère. C’est toujours avec sa mère qu’il se rendait à ces cérémonies qui se déroulaient dans une maison ou bien dans la cour d’une maison, presque clandestinement. Si le milieu décrit dans le livre est tellement cruel, c’est aussi parce qu’il manquait de spiritualité, il était extrêmement matérialiste.
Pour la critique de Télérama, Nathalie Crom (4) le titre français est « empreint d’une sorte de douceur propre à consoler à l’avance de l’âpreté du texte qu’on va lire ». Szilárd Borbély disait lui-même de son livre : « Un univers où il faut couper la gorge d’un être vivant est un espace à part, qui n’a rien à voir avec celui dans lequel les gens font leurs courses dans des supermarchés. Alors moi, j’ai écrit un roman qui évoque un monde archaïque dans lequel la culture a une signification radicalement différente. » (5) Vous êtes familière avec ce « monde archaïque » ? Vous avez des références personnelles sur cette face cachée de la Hongrie ?
Oui, curieusement, j’en ai beaucoup. Mes parents, originaires en partie de Budapest, se sont connus dans une petite ville de la Transdanubie. C’est là où j’ai vécu jusqu’à mes treize ans. Avant leur rencontre, ma mère, jeune professeur, mais ennemie de classe, a été envoyée dans un village pour y créer une école élémentaire pour les Tsiganes. Elle l’a réussi si bien que les villageois l’appelaient « l’ange gardien des Tsiganes ». Deux ans plus tard, elle a été mutée au collège de la petite ville dont j’ai parlé, où elle a enfin pu enseigner les mathématiques. Et c’est la personne qui lui a succédé, la femme d’un secrétaire du Parti, qui a été décorée à sa place. Dans cette petite ville, nous avons connu des gens qui vivaient à la périphérie, dans des maisons en terre battue, dans une pauvreté similaire à celle qui est décrite dans le roman.
Vous avez traduit de nombreux auteurs hongrois et pas toujours les plus faciles. Vos huit traductions de Péter Esterházy, véritable virtuose de la langue hongroise, souvent difficile d’accès même aux lecteurs hongrois, imposent forcément le respect. Comment vous avez vécu cette expérience qui a traumatisé plus d’un de vos confrères ? 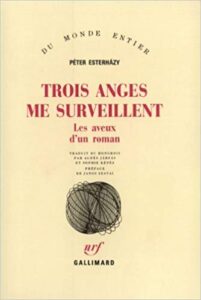 C’était un défi au départ, car c’était ma première traduction. C’était Termelési-regény que Gallimard a publié sous le titre « Trois anges me surveillent » (6). Entre parenthèses, il est dommage d’avoir changé le titre, car aujourd’hui, beaucoup se demandent en France ce que ça veut dire « roman de production ». Or, Termelési-regény est la caricature du genre dont il porte le titre. [Le ‘roman de production’ est un genre littéraire d’origine soviétique dans lequel l’auteur devait raconter le quotidien des ouvriers d’usine et des paysans dans le style du réalisme socialiste.] Aujourd’hui, Gallimard devrait revenir sur le choix du titre. En tout cas, traduire ce livre, c’était une grande joie pour moi. Car, malgré les difficultés, à l’évidence, c’était un jeu. Une construction savante, certes, mais très joyeuse. J’avais reconnu de nombreuses citations qu’Esterházy plaçait dans son texte, ce qui est sa marque de fabrique. Pour prendre un exemple, j’ai reconnu une citation tirée de Maître et Marguerite que j’avais lu en français, ce qui a l’a impressionné. Mais j’avais besoin de sa contribution pour les identifier toutes. Pour reproduire les ruptures de style constantes de l’original, il a fallu retrouver, par exemple, les citations de Goethe dans une traduction d’époque. C’était un gros travail. Je suis moins calée en littérature germanique. Avec lui, j’ai découvert la littérature allemande et autrichienne dont il cite beaucoup d’auteurs. D’où la difficulté de comprendre son œuvre en France. Alors qu’en Allemagne, ses références sont facilement identifiées. Les lecteurs germanophones reconnaissent immédiatement les textes de Thomas Bernhard, de Handke ou de Goethe. Il se réfère peu à Flaubert ou Stendhal. Quoique, tout récemment, dans un livre d’entretiens, il a dit : « Monsieur Bovary, c’est moi ».
C’était un défi au départ, car c’était ma première traduction. C’était Termelési-regény que Gallimard a publié sous le titre « Trois anges me surveillent » (6). Entre parenthèses, il est dommage d’avoir changé le titre, car aujourd’hui, beaucoup se demandent en France ce que ça veut dire « roman de production ». Or, Termelési-regény est la caricature du genre dont il porte le titre. [Le ‘roman de production’ est un genre littéraire d’origine soviétique dans lequel l’auteur devait raconter le quotidien des ouvriers d’usine et des paysans dans le style du réalisme socialiste.] Aujourd’hui, Gallimard devrait revenir sur le choix du titre. En tout cas, traduire ce livre, c’était une grande joie pour moi. Car, malgré les difficultés, à l’évidence, c’était un jeu. Une construction savante, certes, mais très joyeuse. J’avais reconnu de nombreuses citations qu’Esterházy plaçait dans son texte, ce qui est sa marque de fabrique. Pour prendre un exemple, j’ai reconnu une citation tirée de Maître et Marguerite que j’avais lu en français, ce qui a l’a impressionné. Mais j’avais besoin de sa contribution pour les identifier toutes. Pour reproduire les ruptures de style constantes de l’original, il a fallu retrouver, par exemple, les citations de Goethe dans une traduction d’époque. C’était un gros travail. Je suis moins calée en littérature germanique. Avec lui, j’ai découvert la littérature allemande et autrichienne dont il cite beaucoup d’auteurs. D’où la difficulté de comprendre son œuvre en France. Alors qu’en Allemagne, ses références sont facilement identifiées. Les lecteurs germanophones reconnaissent immédiatement les textes de Thomas Bernhard, de Handke ou de Goethe. Il se réfère peu à Flaubert ou Stendhal. Quoique, tout récemment, dans un livre d’entretiens, il a dit : « Monsieur Bovary, c’est moi ».
Quels auteurs hongrois, traduits ou non par vous, sont les plus proches de votre cœur ?
J’aime beaucoup Esterházy. Mais mon jardin secret est Kálmán Mikszáth [1847-1910] dont je voudrais traduire toute l’œuvre en français. J’ai déjà traduit Le Parapluie de Saint-Pierre (7). Dans mon esprit, ce n’était qu’un début, et je me bats pour traduire cet auteur. Dans Termelési-regény, Esterházy consacre tout un chapitre au personnage de Mikszáth qui est l’un de ses écrivains préférés. À juste titre, car il s’agit d’un auteur très moderne pour son époque. Son œuvre constitue une critique féroce de la Hongrie et de sa mentalité à la fin du 19e.
Il était député parlementaire, je crois…
Il était d’abord chroniqueur parlementaire, et ses chroniques remplissent plusieurs volumes. Plus tard, il devient député. Il a d’ailleurs décédé à la suite d’une pneumonie attrapée de sa dernière tournée électorale en 1910, à Fogaras. Il venait de terminer les épreuves de La ville en noir. Je pense que c’est un chef-d’œuvre qu’il faudrait éditer en français. Jean-Luc Moreau a raconté que son professeur, Aurélien Sauvageot avait mis toujours au programme Mikszáth pour la richesse du vocabulaire, la richesse du langage parlé. En lisant Mikszáth, on nage dans le bonheur. En le traduisant aussi. Je ne cache pas que traduire Szilárd Borbély était psychologiquement éprouvant. Par les temps qui courent, tant de crise, tant de peur, lire un ouvrage qui vous réjouit alors qu’il ne cache rien des misères ou des défauts des hommes, cela aide à vivre. La ville en noir est, à mon avis, un ouvrage prémonitoire. Mikszáth a vu l’éclatement de la société hongroise qui devait se produire inévitablement après la Première Guerre mondiale. Il prévoyait le drame. Heureusement, il ne l’a pas vécu.
Vous avez fait des études à la Sorbonne Nouvelle et des recherches sur les manuscrits de Marcel Proust. Comment a débuté votre relation avec la langue, la littérature française ? Et comment êtes-vous devenue traductrice ?
J’avais douze ans quand j’ai lu Les Misérables en traduction hongroise. D’abord, comme tous les enfants de cet âge-là, j’ai sauté allégrement certains passages, surtout consacrés à l’Histoire. Je voulais de l’action. Quand j’ai terminé la lecture, j’étais tellement bouleversée que j’ai décidé de la recommencer. Il est difficile à croire, mais j’ai relu Les Misérables vingt fois de suite. Chaque fois je lisais un peu plus de pages. Les deux dernières fois, je n’ai rien sauté. Je voulais comprendre pourquoi je pleurais toujours à la fin, alors que je connaissais l’histoire. Je me suis rendu compte que l’auteur écrivait de telle façon qu’il était capable de me bouleverser. La clef était donc la langue. C’est comme ça que j’ai découvert le style, la langue d’un auteur. Grâce à Victor Hugo. J’ai effectivement lu tout Mikszáth, tout Jókai, mais c’est Victor Hugo qui a produit le déclic. En traduction hongroise. Mon père qui parlait français me disait comment prononcer les noms. C’est à l’Alliance française de Budapest que j’ai commencé à étudier le français. J’ai même voulu faire des études de littérature française et anglaise à l’université à Budapest, mais, pour des raisons politiques, je n’ai pas été retenue. J’ai essayé quatre fois, puis j’ai pris mon sac à dos et j’ai quitté la Hongrie. J’avais 23 ans. J’avais des amis à Paris et j’avais une tante généreuse aux États-Unis qui m’a envoyé de l’argent pour payer mes études à l’Alliance française et à la Sorbonne. Je suis tombée amoureuse de la littérature française, j’ai laissé tomber l’anglais. J’ai choisi le hongrois comme langue vivante à Paris 3 où j’ai rencontré Jean-Luc Moreau. Je lui ai demandé si je pouvais traduire quelque chose au lieu de passer des examens de déclinaison. Il m’a demandé qui je voudrais traduire. J’ai répondu Kosztolányi sans réfléchir. J’ai dû passer l’examen comme les autres, mais l’année suivante il a créé un séminaire de traduction sur Kosztolányi. Voilà comment a débuté ma carrière. Lors d’une conférence, quelqu’un m’a dit que Gallimard cherchait un traducteur pour Termelési-regény. C’était une heureuse coïncidence.
(1) Szilárd Borbély n’a écrit qu’un seul livre, «La Miséricorde des cœurs», récit bouleversant de son enfance hongroise, Le Temps, (3) juillet 2015
(2) Ábel dans la forêt profonde, Heros-Limite, 2009
(3) Gallimard, 1969, traduit par Véronique Charaire
(4) Télérama, 11 mars 2015
(5) « Qu’ils aient au moins un nom », Interview de Zsolt Kácsor parue dans l’édition de Népszabadság du 10 juin 2013
(6) Avec la collaboration de Sophie Képès
(7) Éditions Viviane Hamy, 1994, 2007