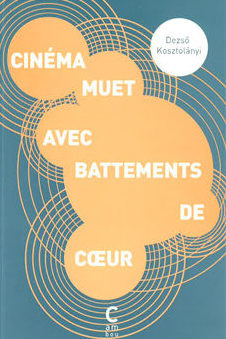Entretien avec Noémi Szécsi, romancière hongroise, lauréate du Prix littéraire de l’Union européenne en 2009 pour son roman Monte-Cristo communiste (Editions Tercium, 2006)
 Vous pensez vraiment que c’est un mauvais présage pour un écrivain d’être né le même jour que Jenő Rejtő ? (C’est ce que prétend la narratrice du roman Monte-Cristo communiste, l’arrière-petite-fille du personnage principal, dont certaines tournures ne sont d’ailleurs pas sans rappeler le style de Rejtő.)
Vous pensez vraiment que c’est un mauvais présage pour un écrivain d’être né le même jour que Jenő Rejtő ? (C’est ce que prétend la narratrice du roman Monte-Cristo communiste, l’arrière-petite-fille du personnage principal, dont certaines tournures ne sont d’ailleurs pas sans rappeler le style de Rejtő.)
Je suis vraiment née le même jour que Jenő Rejtő, le 29 mars – certes, une autre année… D’ailleurs, Kosztolányi a vu également le jour un 29 mars mais le jeu autour de cette date anniversaire fait ici allusion, d’une part, à la question de la compatibilité entre le thème et la tonalité de l’écriture (dans le livre, j’aborde sur un mode satirique les tragédies nationales, thème sacro-saint pour beaucoup) et d’autre part, il témoigne de ma sympathie pour les « outsiders » avec lesquels je m’identifie davantage qu’avec les écrivains établis. Car Jenő Rejtő reste une figure marginale de la littérature hongroise malgré ses nombreux lecteurs et l’empreinte profonde qu’il a laissée sur notre langue et notre façon de penser.
Encouragé par cette parenté rejtőienne entre vous et votre narratrice, je dois vous demander si le personnage de « l’arrière-grand-père », ce boucher végétarien qui porte l’inscription Gesamtkunstwerk tatouée sur sa poitrine musclée s’inspire de la réalité ?
Non. Ce personnage est même tellement fictif qu’il a en fait vu le jour dans un roman de Krúdy, intitulé Bukfenc. Sanyika, l’enfant illégitime du livre, devient chez moi Sanyi, jeune garçon-boucher, modèle à l’Ecole des Beaux Arts, puis révolutionnaire. Je crois que l’une des raisons pour lesquelles mes œuvres se distinguent du courant dominant de la littérature hongroise est l’absence d’éléments directement autobiographiques. Sanyi est un personnage minutieusement construit, même si tous les éléments de sa vie sont réels. Ils ont été puisés dans diverses sources (autobiographies, mémoires, articles de presse, etc.), puis réunis dans le destin d’un seul personnage emblématique : un citoyen ordinaire qui essaie de survivre aux changements politiques de la première moitié du XXe siècle.
A propos de ce Monte-Cristo communiste, l’arrière-petite-fille souligne à plusieurs reprises que si c’était un bel homme, il était peu intelligent. Pourtant, cet homme endurci par les tempêtes de l’Histoire se rend vite compte que sa vie n’est qu’une succession d’événements irrationnels et, dans la mesure du possible, il s’adapte avec succès aux contradictions du monde qui l’entoure. Vous pensez que ce mode de vie schizophrénique est un phénomène typique de la Hongrie ou du XXe siècle ?
Si Sanyi s’estimait intelligent ou si son entourage le considérait comme tel, le destin ne lui épargnerait pas les rôles politiques. De toute façon, il se mêle sans cesse de politique mais il subit plutôt les événements qu’il ne les détermine.
Dans une certaine mesure, le contraste entre sa profession et ses habitudes alimentaires témoigne de cette contradiction : c’est un homme doux, mais ses mains sont tachées de sang – l’homme n’a pu traverser cette époque sans se compromettre d’une façon ou d’une autre.
C’est l’histoire d’un Monte-Cristo qui ne se venge pas, car il refuse de répondre à la violence par la violence, à l’idiotie par l’idiotie. Le destin de Sanyi symbolise l’absurdité du cycle de la vengeance entre les camps politiques qui se succèdent au pouvoir.
Tandis que Monte-Cristo communiste est marqué par un humour absurde, éclatant, le style de votre autre roman historique, Nyughatatlanok (Tourmentés) est beaucoup plus retenu, il évoque franchement le XIXe siècle. Quels écrivains, quelles littératures ont influencé ou influencent encore votre écriture ?
Diplômée en littérature anglaise et finlandaise, j’ai été surtout influencée par la littérature féminine anglaise et scandinave. Mes écrits fonctionnent mieux en dehors du contexte littéraire hongrois, j’en suis encore plus persuadée maintenant que mon roman Vampire finno-ougrien a été publié en anglais. D’une manière paradoxale, plus l’écriture prend possession de ma vie, moins je lis de littérature, et si j’en lis c’est presque toujours pour étudier quelques solutions techniques. Auparavant, j’aimais lire mes livres préférés pour le plaisir, aujourd’hui, je sais pourquoi je les admire : je ne cesse de parcourir et de disséquer les phrases denses, poétiques, atmosphériques de Kosztolányi ; Gyula Krúdy n’excelle pas seulement dans la création de personnages et l’individualisation, il maîtrise aussi sa matière avec un talent inimitable ; je suis fascinée par l’esprit, la largeur des perspectives et l’ironie d’Antal Szerb. Cependant, les procédés et la largesse de vue du roman long, ce sont les auteurs anglais et français du XIXe qui me les enseignent. Depuis mon adolescence, je retourne régulièrement à Balzac, Flaubert et George Eliot.
La révolution et la guerre d’indépendance de 1848-1849 est une matière littéraire riche, largement exploitée. Tourmentés en revanche, se déroule dans les années moroses, sans gloire qui suivent l’échec. Ses protagonistes sont des anciens combattants de la liberté contraints à l’exil. Pourquoi avez-vous choisi cette époque, ce milieu ?
Je voulais absolument écrire un roman d’épouvante et les recherches que j’ai menées à cet effet m’ont appris à quel point la pratique des tables tournantes, qui avait commencé à faire fureur en Europe à partir de 1853, avait conquis les Hongrois, plongés dans la dépression après la défaite de la guerre d’indépendance en 1849.
Les émigrés tout autant que ceux qui étaient restés en Hongrie, invoquaient leurs défunts pour trouver des réponses aux questions qu’ils se posaient sur leur propre sort et celui de leur pays. Par exemple, Bertalan Szemere, ancien ministre de Kossuth, réfugié alors à Paris, interrogeait l’esprit de sa mère sur la date éventuelle de son retour au pays.
Les âmes tourmentées s’accrochant à l’irrationnel sont légion encore aujourd’hui, mais vivre loin de son pays n’est plus considéré comme l’un des pires malheurs qui puisse arriver à quelqu’un. Je voulais analyser en détail comment, dans les circonstances historiques tragiques du roman, ces émigrés définissaient le concept de patrie, d’identité nationale et du « chez soi ». Il me semblait intéressant d’aborder cette question du point de vue de la famille et de la femme. Par conséquent, le protagoniste du roman est l’épouse d’un combattant de la liberté hongrois, une écossaise dotée de pouvoirs de médium.
La tradition littéraire hongroise est assez prude, on n’a pas l’habitude de représenter les grandes figures de l’histoire nationales dans des situations ambiguës. Pourtant, vous le faites plus d’une fois avec vos combattants de la liberté, ce qui apporte une fraîcheur particulière à ces personnages du XIXe siècle. Vous n’aviez pas l’impression de commettre un sacrilège en représentant des défenseurs de la patrie gays ou fumeurs de haschich ?
Ce qui m’intéresse en premier lieu, c’est la possibilité d’être sacrilège, même si ces choses là ne sont considérées comme tabou qu’en Hongrie. Je n’ai pas cherché à faire entrer de force ces détails dans le roman, pour le rendre plus actuel : dans les sources, j’ai cherché et trouvé des traits reflétant une réalité humaine.
La présence d’homosexuels parmi les combattants de la liberté n’est pas « prouvée » mais l’album photo des émigrants a été établi par Károly Kertbeny, un « défenseurs des droits des homosexuels » de l’époque, celui qui a utilisé l’expression « homosexuel » pour la première fois.
De nombreux émigrés menant une existence morne en Turquie sont devenus dépendants aux diverses drogues qu’ils ont essayées là-bas. Et naturellement, à cette époque aussi, les gens traversaient des crises conjugales et entretenaient des maîtresses. Gyula Andrássy, qu’on appelait à Paris « le beau pendu », gaspillait la pension que sa mère lui envoyait pour une célèbre courtisane parisienne et Madame Károlyi, Karolina Zichy, élevait en exil un enfant né de sa relation illégitime avec György Klapka, général de la guerre d’indépendance. Il m’a été difficile de dénicher ces petites choses quotidiennes, très humaines dans des sources hongroises où les héros parfaits de l’histoire nationale sont représentés comme des personnages sans aspérité, dépourvus de toute faiblesse. Même si ces derniers temps, certains changements positifs sont perceptibles dans l’historiographie hongroise.
Vous semblez vous déplacer avec un naturel déconcertant dans le décor de la Hongrie des XXe et XIXe siècles. Comment préparez-vous vos romans historiques ? Et pourquoi le passé est-il plus attirant que le présent ?
Pour Monte-Cristo communiste, j’ai réappris l’histoire hongroise, non dans les manuels d’histoire mais à partir de sources de première main. Et pour préparer Tourmentés, j’ai appris à lire en français, pour mieux étudier le contexte de ce roman qui se déroule en effet entre Biarritz, Marseille, Paris, Bruxelles et Ostende. J’ai coutume de toujours privilégier les biographies, les mémoires et les correspondances qui m’aident à m’identifier à l’esprit de l’époque et à comprendre l’image que les gens d’alors avaient d’eux-mêmes, la manière dont ils vivaient les situations quotidiennes.
J’ai également écrit des romans qui se passent dans le présent (Vampire finno-ougrien, Dernier centaure) mais je préfère sans doute le contexte historique qui me permet de garder mes distances avec mon sujet. Le présent m’engloutit, je n’arrive pas trouver autant de points de vue différents sur lui que ceux que m’offre la distance d’un monde plus éloigné dans le temps.
Vous avez écrit des romans sur un vampire insatisfait de sa vie de vampire (Vampire finno-ougrien), des livreurs à vélo anarchistes (Dernier centaure) ou un boucher communiste traversant les tempêtes du XXe siècle (Monte-Cristo communiste). Vous semblez apprécier la diversité des genres et des thèmes. Quel est l’univers de votre prochain livre ?
Au cours de ces deux dernières années, je me suis plongée dans les représentations littéraires des sourds et dans l’histoire de l’éducation des sourds-muets. Je travaille sur un roman dont le narrateur est un garçon qui est sourd. Se déroulant au XIXe siècle, c’est également un roman historique mais l’Histoire n’y joue pas un rôle majeur. J’ai toujours été intéressée par les existences marginales, périphériques. J’espère que mes lecteurs vont réfléchir, au moins pendant la durée du roman, à ce que signifie vivre dans un monde sans sons.
Pour conclure, une question sans intérêt : pourquoi il manque l’article dans vos titres ?
C’est une décision volontaire. Le titre ne se réfère jamais à une personne en particulier : dans Vampire finno-ougrienc’est la grand-mère du protagoniste qui fait imprimer ce titre sur sa carte de visite, comme profession, dans Monte-Cristo communiste, le titre fait plutôt allusion au genre du récit, un roman de la vengeance, et non au protagoniste, Dernier centaure raconte l’histoire d’un groupe de quatre personnes et Tourmentés représente plutôt un sentiment général qu’une communauté concrète.
Interview, traduction : Gábor Orbán