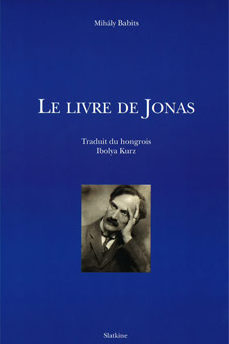Anna Szabó T. poétesse, traductrice était l’invitée de l’Institut hongrois de Paris dans le cadre du Festival POESIR. A l’occasion de cette rencontre intitulée « La poésie des parfums – le parfum de la poésie », nous l’avons interrogée sur la relation entre les sens et la poésie.
 Dans l’une de vos interviews, vous évoquiez en ces termes l’importance des sens : « Pour moi, la vue et le toucher, bien que totalement différents, sont les sens les plus importants. La vue, c’est la distance, le toucher l’expérimentation. En hongrois, les mots « értés » (compréhension) et « érintés » (toucher) se ressemblent et cette ressemblance a son importance : nous ne pouvons réellement comprendre, connaître, identifier qu’en touchant. La vue vient en premier, puis le toucher et la compréhension. Du moins, c’est ce que je croyais jusqu’à la naissance de mes enfants. Chez les enfants, les deux sont inséparables, je dirais même que le toucher prédomine. » (Heti Válasz, mars 2007) L’un de vos poèmes traduits en français (Népstadion metromegálló) est directement basé sur un jeu de points de vue. Il représente le même thème sous huit angles différents. Dans votre hiérarchie des sens, quelle est la place de l’odorat ? Dans quelle mesure le titre « la poésie des parfums » s’applique à votre poésie ?
Dans l’une de vos interviews, vous évoquiez en ces termes l’importance des sens : « Pour moi, la vue et le toucher, bien que totalement différents, sont les sens les plus importants. La vue, c’est la distance, le toucher l’expérimentation. En hongrois, les mots « értés » (compréhension) et « érintés » (toucher) se ressemblent et cette ressemblance a son importance : nous ne pouvons réellement comprendre, connaître, identifier qu’en touchant. La vue vient en premier, puis le toucher et la compréhension. Du moins, c’est ce que je croyais jusqu’à la naissance de mes enfants. Chez les enfants, les deux sont inséparables, je dirais même que le toucher prédomine. » (Heti Válasz, mars 2007) L’un de vos poèmes traduits en français (Népstadion metromegálló) est directement basé sur un jeu de points de vue. Il représente le même thème sous huit angles différents. Dans votre hiérarchie des sens, quelle est la place de l’odorat ? Dans quelle mesure le titre « la poésie des parfums » s’applique à votre poésie ?
Ce fut très instructif de relire mes poèmes de ce point de vue. J’ai été moi-même surprise par les nombreuses références à des odeurs, à des parfums. Cela traduisait certainement l’intensité de ma perception : à cette époque où j’écrivais beaucoup de poèmes, ma voix était plus extatique, les parfums y étaient plus récurrents que dans mon dernier recueil intitulé Villany (Electricité) dont les poèmes traitent, en partie, de combustion ou du risque de se consumer totalement. Les mauvais jours, c’est le plaisir de l’odorat qui semble-t-il disparaît en premier, en tous cas chez moi, c’est comme cela. D’après mes lectures, il s’agit d’un phénomène physiologique : on s’habitue facilement aux odeurs, après un certain temps, on ne les perçoit même plus. Ce n’est pas seulement l’âge qui émousse nos sens mais l’accoutumance aussi. Nous pouvons nous habituer à tel point à notre propre parfum que nous ne le sentons plus, tandis que notre entourage en souffre. De même, on s’habitue à la vie, à l’odeur de la vie pour ne plus la sentir du tout. Pourtant, les parfums sont en relation avec l’une de nos fonctions primordiales, la respiration, et par conséquent, avec notre âme. Si nous n’apprécions plus à sa juste valeur, ou n’avons plus même conscience de notre respiration – alors que les bébés, eux, sont continuellement en train d’exercer leur bouche, leur nez, leurs poumons, reniflent tout, portent tout à leur bouche – on perd également la perception de la vie. Le parfum est énergie, il nous aide à prendre conscience à quel point la vie est excitante.
En tant que traductrice de James Joyce, Sylvia Plath, W. B. Yeats, John Updike et Stuart Parker, vous entretenez des relations étroites avec la littérature anglo-saxonne. Votre critique de Maupassant, parue dans Népszabadság (janvier 2009), est la preuve que la littérature française ne vous est pas inconnue non plus. Parmi les qualités d’Une vie, vous mettez l’accent sur l’expressivité presque charnelle : « Pleines de saveurs, d’odeurs, de voix : les phrases disciplinées bouillonnent d’érotisme – peu de romans offrent tant de descriptions de paysage brillantes, aériennes, précises et heureuses, tant de plaisir libéré, panthéiste, sensuel. » Un certain panthéisme n’est pas étranger à votre poésie non plus :
« J’ignore qui je suis, quel est mon but –
le ciel et la terre m’ont acceptée.
Je respire à pleins poumons le parfum matinal du sureau,
frais et doux.
(Une clairière dans le brouillard)
En lisant votre poème, on a l’impression que ce n’est qu’à travers les phénomènes de la nature, perceptibles par nos seuls sens, que nous pouvons espérer obtenir quelques fragments de réponses à nos questions les plus importantes.
Vous l’avez si bien formulé que je ne peux pas faire mieux. La réflexion intense a toujours mené à des paradoxes et des doutes tandis que le plaisir de la perception conduit à la simplicité et à l’union. Dans ce poème écrit après la naissance de mon premier enfant, je laisse l’air, c’est-à-dire la vie, me pénétrer – l’odeur de la décomposition est aussi naturelle que l’odeur intense des fleurs. […] Dans un autre poème intitulé Csapda (Piège), j’ai formulé la même idée de la façon suivante : « je ne peux pas me priver / de cette drogue, l’envie de vivre ». Par le fait de donner la vie, la mère ouvre une nouvelle porte à la mort et accepte le cercle de la vie – cette grande inspiration à plein poumon est suivie d’une grande expiration, un soupir : on n’a pas d’autre solution que de se laisser porter par la vie et la mort. Est-ce du panthéisme ? Peut-être. Les parfums sont particulièrement habiles à mettre en relation la chair et l’âme : le parfum volatile de la matière terrestre n’est pas sans rappeler la volatilité de l’âme.
Interview-traduction Gábor Orbán
Poèmes d’Anna Szabó T. dans la traduction brute de Gábor Orbán et Anne Veevaert
Ecriture chiffréeUne senteur qui n’a pas de nom
se niche dans ma mémoire
incapable de l’associer à quoi que ce soit
cet instant si riche de senteur
impossible d’en parler, de le citer
s’arrêter pour humer l’air
quelque chose est là qu’on ne peut nommer
tu te souviens mais tu ne sais de quoi*
lire les signes
la calligraphie des racines
l’écriture des vers dans la terre
les lettres noueuses des campagnols
les poèmes des insectes entre les feuilles mortes
et ceux des fourmis sur l’écorce des arbres
comme le nez du renard
humant le sol de la forêt automnale
ThéâtreDu papier mâché, rien qu’un décor, il ne comprend pas
d’où vient cette odeur étrange, pénétrante,
une odeur de mousse, de feuilles mortes, de bête sauvage,
pendant que les mains de Titania caressent
les répugnantes oreilles de l’âne,
que l’homme se dévêtit à moitié,
il se souvient soudain, cette scène, trois ans plus tôt
ils avaient marché tous les deux,
de retour chez lui, il avait bu,
agrippant le combiné muet,
couché sur le tapis, nu,
tremblant et hoquetant, il avait pleuré.
Pluiedes nuées planent au dessus de Pest
des pétales de lilas emportés par le vent
l’odeur des corps dans la moiteur du bus
mais c’est déjà mieux que rien
un éclair flambe au dessus de Pest
l’espace se contracte et se dilate
habitue tes yeux à la lumière
car c’est déjà mieux que rien
l’averse siffle au dessus de Pest
elle frappe l’asphalte et non la terre
les cieux indolents nous inondent de leur pluie
mais c’est déjà mieux que rien.
Ne pas êtreNe pas tourner, se retourner dans son lit dans un demi-sommeil.
Ne pas s’endormir, ne pas se réveiller.
Ne pas acheter de lait au supermarché.
Ne pas sentir le parfum du tilleul.
Ne pas scruter le ciel pour voir s’il va pleuvoir.
Ne pas s’angoisser avant la décision.
Ne pas gratter l’écorce pourrissante des arbres.
Ne pas ouvrir, ne pas fermer, ne pas rouvrir, ne pas refermer.
Ne pas en savoir plus.
Et ne pas en savoir plus
Une clairière dans le brouillard
Je sens sur ma peau les griffures
obstinées de l’herbe mouillée
qui rampe, lourde, aveugle
vers le sein du nuage
gouttant de pluie.
Autour de moi flottent des odeurs de feuilles mortes,
de décomposition, d’humus
broyé par les cloportes, habité par les insectes,
creusé par les lombrics.
J’ignore qui je suis, quel est mon but –
le ciel et la terre m’ont acceptée.
Je respire à pleins poumons le parfum matinal du sureau,
frais et doux.
CercueilEaux mortes de la nuit, prés non fauchés.
Nul vent ne trouble l’obscurité immobile.
L’espace rétrécit, les mottes de terre brisent nos corps,
la couverture pique, l’air se fait rare.
Nous gisons, apathiques et sans sommeil,
la toile de tente a une odeur de terre,
tout autour, les cricris des grillons,
telle une démangeaison qu’on ne pourrait soulager.
Obscurité de la pluiefeu de camp
brûle
l’herbe, l’eau et le silence
exhalent leurs vapeurs
sous l’anorak
le dos frissonne
hérissé de chair de poule
la moiteur des fibres, du corps,
de l’arbre
la chaleur s’échappe
les vapeurs ondoient
les bûches humides
crépitantes,
exhalent des effluves de fumée
la mort
un frêle halo entoure la flamme du bois mort
son âme se consume
transparente, telle une averse
mais qui s’élève
odeur de corps et de pluie, odeur de terre
flammèches des herbes
des pétales sur le sol, partout
des éclats de senteurs
le froid hérisse le feu, apporte la pluie
vent odeur d’automne
sous le ciel bruissent les feuillages secs
il faut
te rendre
Elle m’abandonne
(extrait)
Elle me trahit et m’abandonne.
Elle m’expulse hors de son ventre et m’abandonne.
Elle me nourrit de sa propre chair et m’abandonne.
Elle me berce et m’abandonne.
Elle me caresse le pied, m’essuie les fesses,
me peigne les cheveux, m’abandonne.
Je m’enivre de son odeur, elle m’embrasse :
« Je ne t’abandonnerai jamais ! » Elle m’abandonne.
Elle m’enjôle, elle me chuchote dans un sourire : « N’aie pas peur ! »
J’ai peur, j’ai froid et elle m’abandonne.
Le soir, elle se couche à mes côtés,
puis elle s’esquive et m’abandonne.