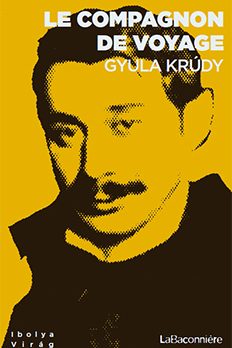Entretien avec György Dragomán dont le second roman vient de paraître aux éditions Gallimard (Le Bûcher, trad. Joëlle Dufeuilly).

Après Le Roi blanc (1), Gallimard publie cette année la traduction de votre second roman, Le Bûcher paru en 2014, qui, sur bien des aspects, entretient des liens étroits avec le premier. Comment avez-vous vécu l’accueil par le public français du Roi blanc qui a remporté un succès retentissant dans un grand nombre de pays ?
Après sa publication, le Roi blanc a été sélectionné pour participer au concours des meilleures traductions de roman et, quelques années plus tard, il a remporté, face à des concurrents très sérieux, le prix Jan Michalski. Maintes critiques louangeuses ont accompagné sa sortie et j’ai moi-même reçu des lettres chaleureuses de plusieurs lecteurs. Grâce à mon livre, je me suis rendu à plusieurs reprises en France pour participer à des festivals et j’ai vu qu’il était apprécié des lecteurs.
Le roman s’articule à la fois autour du récit de la réalité familiale, scolaire, historique et sociale telle que la perçoit le personnage principal d’Emma et autour de l’univers empreint d’éléments magiques que fait naître la grand-mère par sa personnalité. En hongrois, le titre suggère que la magie (« mágia »), mot phonétiquement proche de bûcher (« máglya ») dans cette langue, joue un rôle important dans le livre. Cette allusion disparaît du titre français (Le Bûcher). Cela ne vous gêne pas ?
Lorsque m’est venue l’idée de ce titre, je savais qu’il ne faciliterait pas la tâche du traducteur et qu’il serait impossible de transposer dans une autre langue l’ambiguïté du terme hongrois. Le caractère intraduisible d’un texte ne saurait toutefois entrer en ligne de compte dans le processus d’écriture, le livre doit quand même fonctionner sans le jeu de mots du titre, l’essentiel n’est pas là, ce qui compte ce sont les vibrations du texte en prose, le récit qui entraîne le lecteur dans son tourbillon. Le succès des traductions publiées jusqu’ici montre que le roman tient debout malgré cela.
Tant Le Roi blanc que Le Bûcher reposent sur un parti pris narratif intéressant, consistant à entretenir un certain « flottement » et à ne donner aucun repère spatial ou temporel précis au récit. Seules quelques allusions permettent d’esquisser les contours d’un pays (la Roumanie) et d’un moment particulier de l’Histoire (le changement de régime). Nous quittons en fait le genre traditionnel du roman historique, les lecteurs pouvant facilement se retrouver dans la réalité politique, historique et sociale vécue par Emma qui, sans être identique ni s’ancrer dans le même décor, ressemble au moins partiellement à celle qu’ils ont eux-mêmes vécue. Ce parti pris a-t-il contribué au remarquable succès international des deux romans ?
Mon écriture s’inspire de mes visions et, tout en travaillant, je me suis vite rendu compte que je ne pouvais pas écrire un roman historique au sens classique du terme, car plutôt que de m’intéresser à la description d’événements passés, je voulais avant tout reconstruire le plus fidèlement possible l’empreinte émotionnelle de l’époque.
N’importe quelle recherche historique est capable d’éclairer les faits (même si, bien sûr, ce type de travail aussi pose la question de la reconstruction des événements historiques).
Ce qui m’intéressait, c’était de décrire le climat émotionnel de l’époque de manière aussi pénétrante que possible.
Le lecteur entre pour ainsi dire dans la peau des personnages, il respire avec eux, ressent l’atmosphère de l’époque dans sa chair. Si le récit ne décrit aucun fait réel, il donne une image très précise de l’époque, et de nombreuses personnes de mon âge, vivant dans différentes régions du monde, m’ont écrit que grâce à mes livres elles avaient pu comprendre sans l’avoir vécu le destin de leurs proches. C’est peut-être pour cela, pour la faculté d’identification qu’ils donnent, que les lecteurs aiment mes livres. J’en ai discuté avec des historiens et certains m’ont dit que seule la littérature pouvait offrir une telle justesse et une telle authenticité, elle permet non seulement de vivre, mais aussi de comprendre l’époque et les processus historiques mis en jeu.
« C’est l’après-midi, je viens d’enlever ma jupe et mes collants pour enfiler ma tenue d’intérieur et au moment où je pose mon pied sur le plancher, je ressens brusquement une douleur au ventre. Comme ce matin, pendant la récréation, mais en plus fort, beaucoup plus fort. Je n’ai jamais ressenti une telle douleur. Je ne peux plus bouger, je reste là, pieds nus sur le plancher, et je sens la douleur se diffuser. C’est une douleur interne qui me comprime, me crispe, me tire violemment vers le bas. » (2)
Comment György Dragomán a-t-il pu donner corps au personnage d’Emma ? Quels procédés et quels outils avez-vous mobilisés pour décrire avec autant de justesse les transformations psychologiques et physiques de cette jeune orpheline adolescente ?
Je me suis remémoré de manière très précise ma propre adolescence, j’ai dû remonter dans le passé, retrouver les moments de solitude et la sensation physique intense d’habiter totalement mon corps afin de pouvoir me glisser dans la peau d’une autre personne. Le fait d’être un homme alors qu’Emma est un personnage féminin est moins important à cet égard que les différences qui distinguent les traits de sa personnalité de la mienne à cette époque. Observer, ressentir et éprouver les vibrations les plus profondes d’une autre personne fut pour moi une expérience très intime.
Du reste, je n’avais pas prévu que mon personnage serait une jeune fille quand j’ai commencé à écrire le roman, au départ j’imaginais un héros masculin, mais en voyant ses mains, ses mouvements, et je me suis peu à peu rendu à l’évidence.
Si mon personnage est plus audacieux et plus sauvage que je ne l’étais à cet âge, j’ai traversé les mêmes moments intenses et excitants de solitude, j’ai emprunté le même chemin douloureux par lequel l’adolescent apprend à se connaître, à identifier les talents qu’il recèle en lui. La douloureuse lutte qu’Emma engage pour accéder à cette connaissance de soi est similaire à celle que j’ai menée. Bien sûr, la tâche d’Emma est plus difficile et elle porte un fardeau bien plus lourd.
Dans son analyse du Roi blanc, Gabrielle Napoli décrit ainsi l’un des procédés utilisés par l’auteur : le fait que l’esprit du jeune Djata ne cherche pas à interpréter les événements qu’il observe et qu’il vit met encore plus clairement en évidence l’absurdité du régime en place. En lisant Le Bûcher, le lecteur peut percevoir des caractéristiques analogues dans le comportement d’Emma. La jeune fille ne prête aucune attention aux secrets et aux mensonges, aux pêchés et aux jugements moraux des générations précédentes et n’adopte pas non plus les mauvaises habitudes que ceux-ci engendrent. En ce sens, Emma est une métaphore de la liberté et du changement de régime. Quel regard portez-vous sur la jeunesse d’aujourd’hui ? Recèle-t-elle comme Emma suffisamment de force en elle pour faire preuve d’ouverture et être le moteur d’un changement positif ?
Mon adolescence a été pour moi une période magique : j’étais libéré de la dictature, autour de moi le régime s’effondrait, je suis tombé amoureux, j’ai pris conscience de mon désir de devenir écrivain.
C’était une liberté vécue dans toute sa plénitude et je pense que tout adolescent doit pouvoir faire l’expérience de cette libération débridée.
À l’adolescence, on a l’impression de pouvoir traverser les murs et parfois, de fait, on y parvient. J’ai écrit Le Bûcher en m’inspirant de cette expérience parfois presque romantique de la liberté ; en dépit de son atmosphère sombre et oppressante, le roman tire sa force de cet esprit de « rébellion généralisée » propre à l’adolescence. Je suis sûr que la jeunesse d’aujourd’hui possède également cette force et j’espère vraiment qu’elle sera capable de prendre en main son destin, de vivre et de faire l’expérience de sa propre liberté.
Dans un entretien que vous avez accordé au journal Magyar Narancs (2015), vous annoncez être en train d’écrire un roman qui sera la « suite » du Roi blanc et du Bûcher, dans lequel un enfant de six ans dialogue avec lui-même, vingt-cinq ans plus tard. Comment parvenez-vous à rompre avec cette représentation du monde à travers la conscience d’un enfant ? Quelle direction prend la dernière partie de la trilogie ?
Le Bûcher laisse déjà de la place au regard de la grand-mère, dans ce roman-là non plus le point de vue de l’enfant n’est pas celui qui domine. Mon troisième livre fonctionnera un peu différemment ; je sens que je ne dois pas seulement m’efforcer de revenir au cœur des heures sombres de la dictature, mais qu’il me faut aussi, en quelque sorte, affronter les conséquences de ce régime à moyen terme. J’espère vraiment que les trois livres pourront être publiés en un seul recueil, une fois que j’aurai terminé. Heureusement, d’autres sujets m’occupent : j’ai écrit quantité de nouvelles qui ne sont pas liées, ou en tout cas pas systématiquement, à cet univers et, dans le secret de mon bureau, des romans d’une tout autre nature sont déjà en train de voir le jour.
(1) György Dragomán, Le Roi blanc [A feher kiraly]. Trad. du hongrois par Joëlle Dufeuilly. Collection Du monde entier, Gallimard. 2009.
(2) György Dragomán, Le Bûcher [Máglya]. Trad. du hongrois par Joëlle Dufeuilly. Collection Du monde entier, Gallimard p. 131.
Interview : Gábor Orbán
Traduction : Anne Veevaert